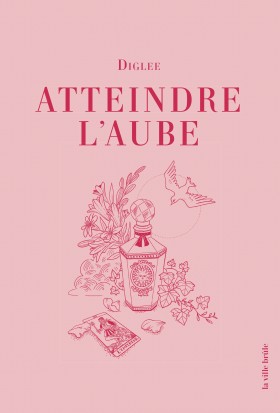Nadège Erika est née au milieu des années 1970 dans le quartier de Belleville à Paris. Après avoir quitté l’école en 3e, elle a repris ses études à 30 ans et travaille aujourd’hui comme éducatrice spécialisée. Récit inspiré de sa propre histoire, Mon petit, son premier roman, décrit la colère de cette amoureuse de Belleville, après la mort de son bébé âgé de quelques mois.
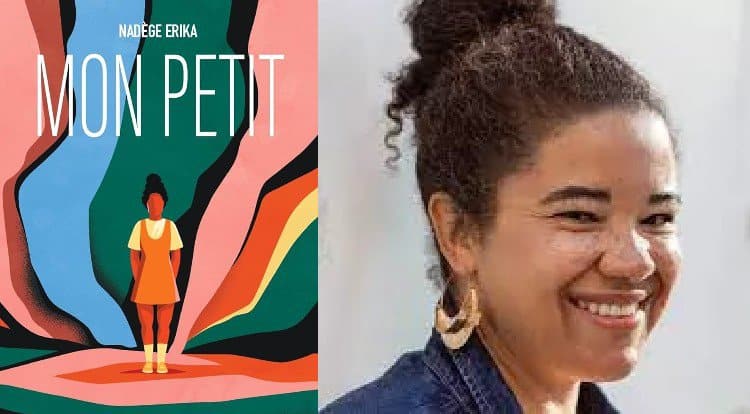
Une invitation dans une intimité
Tout d’abord, Nadège Érika nous propose de suivre son itinéraire et le lectorat se rend bien vite compte que la narratrice est seule. Malgré la surpopulation autour d’elle, dans sa famille, dans les rues de Paris qu’elle sillonne aisément, dans son foyer, elle est toujours seule et nous, lecteur.trice, nous nous retrouvons tantôt dans la position du.de la confident.e tantôt dans la position de l’accompagnateur.trice. Une fois adulte, quand elle revient dans l’appartement de sa Grand-Maman dans lequel elle, son frère et sœurs ont grandi, c’est tout naturellement qu’elle nous fait partager ses désirs les plus intimes :
« Je m’approche de la porte de notre appartement, m’arrête sur le seuil, et revois ce trois pièces qui m’a vue « naître », grandir, où j’ai appris à lire, à rire. Je pourrais sonner, me présenter et demander à entrer, mais je n’ose pas le faire. Alors, je ferme les yeux et, plantée sur le paillasson, j’entre comme dans un rêve chez les inconnus qui vivent aujourd’hui chez nous ».
S’ensuivent une description physique et spatiale de l’appartement avec une grande précision, une animation du lieu de vie avec les membres de sa famille et une narration des souvenirs d’enfance des plus joyeuses. On découvre un personnage d’une grande sensibilité qui nous fait vivre une balade intérieure à laquelle peu de personnes ont eu accès.
Le livre est donc un long monologue intérieur de l’autrice qui se rappelle et qui nous livre une cascade de souvenirs. Ils peuvent être réjouissants et pleins de vie :
« J’attendais les frites, tout le temps j’attendais les frites, et quand venait enfin le jour, le temps me semblait long. J’avais l’impression qu’il fallait des heures à Grand-Maman pour éplucher les patates et les faire tremper afin qu’elles libèrent l’amidon qui les rendraient sinon collantes. Je devais encore attendre qu’elle les ai plongées dans la bassine à friture, ce monstre qui rendait Grand-Maman encore plus vigilante avec nous ».
Ce moment, certes qui met en évidence une grande impatience de l’enfant, ne peut que faire sourire car en évoquant là une attitude et une situation que chacun.e a pu vivre, l’autrice crée une véritable complicité avec nous.
Les souvenirs peuvent être parfois moins doux et susciter des chocs. Après avoir eu ses premiers enfants à l’âge de dix-neuf ans, la narratrice donne ce témoignage :
« Finalement, la brune assez jolie s’en moquaient un peu des jumeaux. Elle voulait savoir si j’étais intéressée pour faire d’autres baby-sitting. C’était la première fois qu’on me prenait pour la nounou de mes fils ! C’est sûr qu’une jeune fille noire accompagnée de deux petits Blancs aux yeux bleu-vert, c’était forcément la nounou congolaise. »
A plusieurs reprises, l’autrice évoque en toute transparence les préjugés, liés à sa couleur de peau, dont elle a été victime : la sphère familiale n’y échappe pas. Mais elle les évoque sans rancune, plus avec de l’humour et sans s’y éterniser. Ils font partie de son témoignage de vie, comme tant d’autres, mais pas d’une pierre d’achoppement.
Une femme d’expérience
On l’aura compris, Nadège Érika s’exprime sans détours : son style cru, parfois brutal, est complètement assumé. Il correspond bien à son envie de parler de ce qui lui pèse et de parler de la vraie vie. Ce personnage est très souvent à l’extérieur, dans la rue, c’est une femme qui garde les pieds sur terre et dont la maturité est purement empirique. Ayant vécu elle-même toute son enfance dans des HLM à Belleville et à Porte de Montreuil, c’est naturellement qu’elle porte un regard critique et lucide sur l’évolution des bâtiments, quelques années après les avoir quittés :
« L’accès du groupe HLM a été renforcé par de hautes grilles. Je ne comprends pas pourquoi. Je me dis que si c’est dorénavant plus dur d’y entrer, ça doit être encore plus difficile d’en sortir, de cette cité. Si on met des maisons en cage, faut penser qu’il y a tout de même des personnes dedans qui voudront s’en échapper ».
L’automatisme de penser d’abord à l’état et au bien-être des personnes locataires et de penser au besoin de partir de ce qui ressemble à une prison relève de l’expérience personnelle le plus profonde.
Par moments, elle évoque la différence de quartier avec beaucoup d’humour. Travaillant dans le médico-social, elle a eu l’occasion de suivre des personnes qui étaient dans de terribles situations. Quand elle a pris en charge une femme à qui on venait d’attribuer un logement, elle commente ainsi le choix du lieu : « Elle avait emménagé dans un appartement à Montreuil. Pas le Montreuil des baskets en cuir végétal, ni des kebabs à 11 euros à la farine de petit épeautre et à la betterave. Pour elle c’était la cité au quartier des Trois-Communes, et ça lui allait bien ». On sent fort bien une critique de la différence criante de niveau social, mais c’est le côté hilarant de la formulation qui prend le dessus.
Une œuvre de la survie
« Existe-t-il seulement des mots pour parler de la mort d’un enfant ? » se demande Nadège Érika. Après la lecture de Mon Petit, on ne peut que répondre oui ! L’autrice les a parfaitement trouvés. Toutes les pensées que peut avoir une mère endeuillée par la mort de son bébé ont été retranscrites, tous les domaines touchés de près ou de loin par cet événement ont été évoqués, toutes les années de réflexion, de culpabilité, de colère ont été racontées, toutes les certitudes et tous les regrets ont été passé.e.s au peigne fin, tous les ravages causés à court et à long terme ont été mentionnés.
On sait tout de suite à quoi s’attendre. Ce livre apparaît d’emblée comme une vraie thérapie et un refuge. Dès les premières lignes, l’autrice nous donne sa définition de l’écriture :
« J’écris pour emballer mes tourments dans un corps de papier et mettre des mots sur une histoire qui en a manqué. Au même titre que d’autres fluides corporels, l’écriture, chez moi, est une sécrétion. Et puis je n’ai plus que ça à faire ».
Cette « sécrétion » comporte un retour, à plusieurs reprises, sur un événement traumatique, mais sous des angles différents, à des âges différents, avec des personnages autour qui sont différents…et avec une sensibilité différente. De la tristesse, oui il y en a, mais à aucun moment on ne veut refermer ce livre.
Nous, lecteurs.trices, accompagnons l’autrice dans son processus de deuil, mais nous ne sommes pas les seul.e.s. La littérature a bien travaillé avant nous :
« Quand je pense à Tiago, me reviennent souvent ces vers de Victor Hugo pour sa défunte fille : Je conviens que vous seul savez ce que vous faites, et que l’homme n’est rien qu’un jonc au vent. […] Il faut que l’herbe pousse et que les enfants meurent ».
Ces mots se trouvent au début d’un chapitre : en plus de savoir immédiatement de quoi il va être question, le lectorat sait aussi quelle orientation va prendre l’évocation de la mort : celle d’une souffrance qui essaie d’accepter. Choisir de s’appuyer sur Victor Hugo c’est bien choisir une communauté d’âmes qui tente d’apaiser la douleur par la beauté du Verbe. Il est bien là le pouvoir de la littérature : réunir, verbaliser, soutenir et vivre, en sachant qu’on est entouré.e.s !
Ainsi, lire Mon petit, c’est vivre à Paris dans les années 80-90, c’est lire ce que l’on veut taire, c’est apprendre à écouter la souffrance de l’autre et c’est connaître parfaitement un tabou de la maternité. Personne ne soupçonne son envie d’entendre une autre nous parler d’elle, sans l’arrêter.

Passionnée de lecture depuis petite, Magaly Jouhateau-Mauriello voit en la littérature la meilleure façon de découvrir l’âme humaine, avec ce qu’elle a de beau mais aussi de plus obscur. Ce domaine, selon elle, est le meilleur moyen de redonner une voix à celles et ceux que l’on a voulu depuis trop longtemps considérer comme muet.te.s.