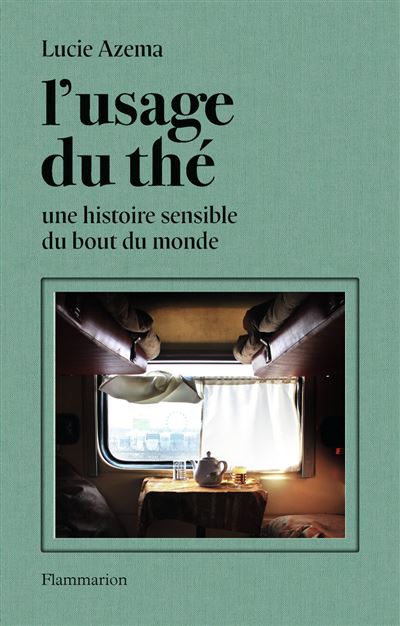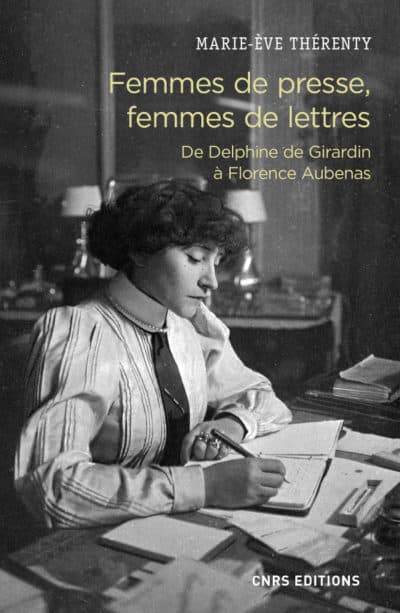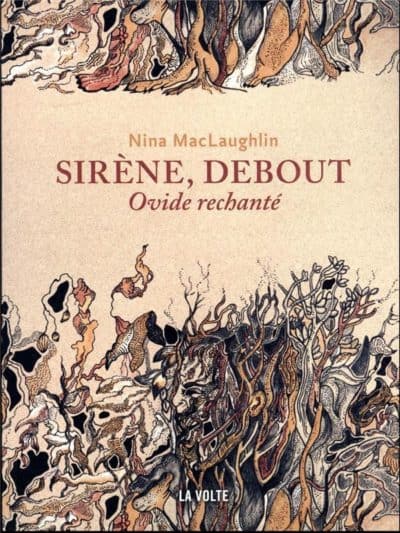D’abord, merci pour cette couverture. Jamais auparavant je n’avais eu l’occasion d’assortir mes vêtements à mes lectures, c’est chose faite. Mon bouquin et moi en total look léopard, j’espère que les usagèr.es de la ligne 9 samedi dernier s’en souviennent !

Trash, vulgoss, pouffe, kitsch, too much… : Valérie Rey-Robert se donne ici la mission d’explorer le « vulgaire » en tant que jugement esthétique dévalorisant, jugement qui s’applique presque exclusivement aux femmes. Mais qui décide du bon goût, de la norme, de l’élégance, de la sophistication, et partant, du vulgaire comme un écart vis-à-vis de cette norme ? Il y a de la sociologie bourdieusienne dans ce texte qui démontre à quel point « le goût c’est le dégoût des goûts des autres ». L’origine latine le rappelle : ce qui est vulgaire, c’est d’abord ce qui vient du peuple, de la foule, ce qui est commun et ordinaire. Apposer le sceau de la vulgarité sur l’autre c’est s’en démarquer, pointer du doigt l’écart. Et en terme d’écart, c’est de genre, de classe et de race dont il s’agit le plus souvent. Claquer un SMIC en homard : pas vulgaire (François de Rugy), manger une entrecôte dorée à l’or fin à Dubaï : vulgaire (Franck Ribéry). Et en général, quand on est une femme, c’est la double peine (triple, quadruple etc si tu ajoutes racisée, grosse, handicapée, lesbienne, trans…). Bref, vous avez compris, puissante ou misérable, pas le même topo.
Si nous ne sommes pas égales devant la sentence, que nous sommes éduquées par nos familles et notre milieu socioculturel pour tenir à bonne distance tout ce qui pourrait nous faire chuter dans la précipice moral et le déclassement de la vulgarité, ce qui est condamné comme vulgaire possède une puissante force d’attraction, un magnétisme qui nous aimante aux clips de Madonna comme aux yeux mi-clos de Marylin Monroe ou aux fesses de Cardi B. Chacune de ces icônes de la pop culture incarne pour certain.e.s, ou a incarné – car le vulgaire évolue dans le temps plus vite que le Beaujolais nouveau – la vulgarité par ses vêtements, ses accessoires, ses attitudes, son mode de vie ou son langage. Chacune subit l’ire des garant.e.s du bon goût qui s’offusquent de, tiens au hasard, voir représenter la France à la cérémonie d’ouverture des J.O par une Aya Nakamura qui ne-parle-même-pas-français-puisqu’on-comprend-rien-quand-elle-chante (nous si, t’inquiète). Et bim, pied de nez, tacle efficace : le Français est autant la langue de Nakamura que celle de Molière et d’Aznavour !
J’ai cru d’abord avoir en main un essai. C’est la forme que prend l’introduction signée par Valérie Rey-Robert, même si les anecdotes personnelles émaillent déjà ces pages. Mais c’est finalement un livre hybride, mi-essai, mi-témoignage : puisque la définition du vulgaire, sa perception, est plurielle, l’autrice confie chacun des chapitres du livre à cinq autres femmes, activistes, journalistes et autrices : Lexie Agresti, Marie de Brauer, Daria Marx, Taous Merakchi et Jennifer Padjemi. Toutes marquées du sceau d’infamie à leur manière, elles disent la vulgarité entrée dans leurs vies comme une insulte, un désaveu, mais aussi parfois l’attirance éprouvée pour le vulgaire comme on quitterait une autoroute monotone pour les chemins de campagne. Ça prend plus de temps et c’est plus difficile pour s’arrêter faire pipi ou boire un café latte, mais c’est plus intéressant.
Des textes qui disent chacun l’écart avec la norme, sa prise de conscience toujours violente, à l’adolescence ou dès l’enfance, ses conséquences en terme de légitimité, d’amour de soi, de confiance, des conséquences qui abîment souvent la santé psychique autant que physique. Toutes disent les tentatives désespérées de rentrer dans le moule, de devenir la « bonne » fille ni trop, ni pas assez, de tenir en équilibre sur la planche savonnée des injonctions contradictoires alors qu’on sait que c’est intenable. Toutes disent la honte, la haine de soi qui prend toutes les formes : camoufler un accent, faire semblant de savoir de quoi parle une assemblée dont on ne maîtrise pas les codes, s’astreindre à des régimes nocifs, se forcer à jouer le jeu de l’hétérosexualité, de coller à son genre assigné. Beaucoup de blessures mais des itinéraires de résistance, des chemins vers l’amour de soi. Le texte se termine en apothéose avec les mots de Daria Marx qui claquent et font chialer à partir du cas de « Melody-avec-un-y » la fille des bouchers rencontrée à l’école primaire, ostracisée et méprisée parce que jugée vulgaire mais qui a représenté pour l’autrice une possibilité d’évasion, un ailleurs désirable et lumineux à l’écart du troupeau toujours indécrottablement « beige ».
« Il faut se méfier des petites filles trop sages, c’est une légende connue. Je comprends mieux à présent pourquoi nos parents se méfiaient de la fille du boucher, de son manque d’entraves. Entre le vide et le plein, entre le trop et le pas assez se créent nos espaces intimes, la possibilité de construction de nos impertinences, un territoire test de nos futures libérations. Faire exister la possibilité d’autre chose, c’est donner du crédit à l’inconnu en soi, à un espace dans lequel la liberté ne peut pas être rappelée à l’ordre, empêchée ou limitée. Se confronter à plus libre que soi, c’est voir en négatif les endroits qui nous inféodent et nous emprisonnent. Passer à la lumière crue du regard de l’autre, c’est autoriser nos hontes à suppurer et à guérir, une occasion de laisser hurler la jalousie, le désir et l’envie. Pardon, Melody, d’avoir gardé pour moi tous les soleils que tu venais d’allumer dans ma tête, merci pour les pulls moches, merci pour le léopard, merci pour l’ailleurs que tu rendais possible. » 1
J’ai le rimmel qui coule sur mes fringues léopard, alors, vulgaire ?
1Daria Marx, chapitre 6 : Melody, pp.144-145.

Après s’être aperçue qu’en 116 ans d’existence le Goncourt avait été attribué à 12 femmes et 104 hommes, elle s’est dit que certes, une chambre à soi et un peu d’argent de côté ça pouvait aider à écrire des livres – et que les femmes manquaient souvent des deux – mais qu’il y avait quand même, peut-être, un petit problème de représentation dans les médias. C’est ainsi qu’elle a décidé de participer à Missives, heureuse de partager son enthousiasme pour les autrices qui la font vibrer, aimer, réfléchir et lutter.