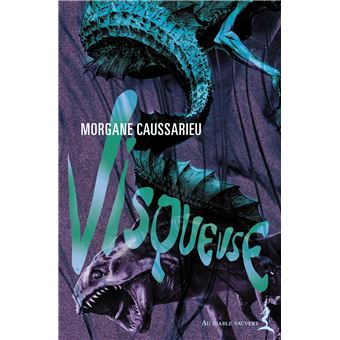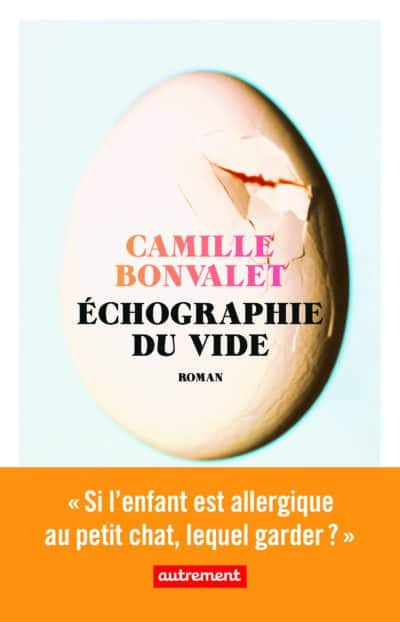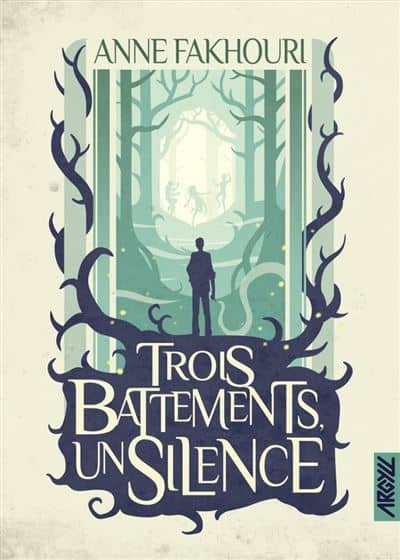Cette chronique doit commencer par un aveu : lors d’un festival, je suis passée à côté des romans de Morgane Caussarieu parce que l’un, Dans tes veines, revisite le mythe du vampire et que j’ai *extrêmement* peur des vampires. (Embarrassant, je sais.) J’ai donc lâchement fui le stand, ratant du même coup Vertèbres, hommage cette fois à la figure du loup-garou sur fond d’années 90. Heureusement, mon affection pour les hybrides draconiques l’a emporté, me glissant entre les mains Visqueuse, troisième de sa série de réécritures monstrueuses. Comme ses prédécesseurs, le roman explore le folklore français, quittant le Sud-Ouest des premiers opus pour le Doubs et s’ancrant dans des années 30 traumatisées par la Grande Guerre, boiteuses comme l’une de ses héroïnes : un pied encore coincé dans la ruralité inchangée du XIXe, l’autre appuyé sur les technologies qui commencent à s’imposer, notamment le cinéma hollywoodien qui se faufile dans les imaginaires. Et comme ses prédécesseurs, le roman tisse légendes régionales, influences fantastiques contemporaines, body horror et imaginaire queer, autour de sa figure centrale.
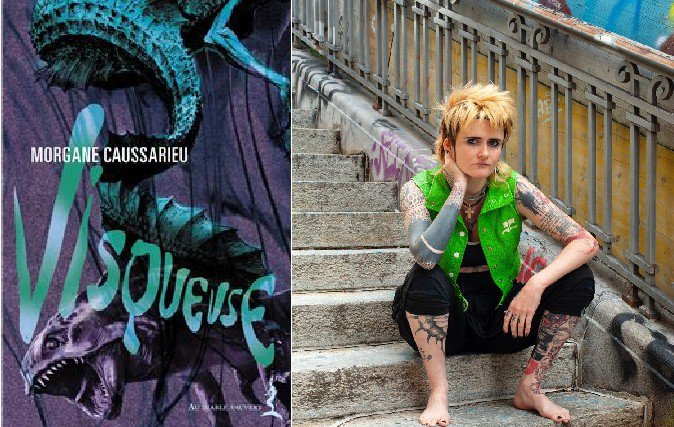
Trouillarde comme je viens d’avouer l’être, je ne suis pas, on l’aura deviné, une immense lectrice de fantastique. Toutefois, celui que je préfère, c’est celui qui semble se défaire de ses ornements fabuleux pour avancer vers des explications apparemment réalistes, mais pour mieux se rhabiller pendant qu’on regarde ailleurs, revêtant les oripeaux d’un autre fantastique, dont il s’hybride pour nous glisser entre les doigts. Le moment où Mulder et Scully ont tous les deux raison. Je vais donc m’abstenir de vous copier-coller que dans Visqueuse, « le monstre n’est pas celui qu’on croit », non seulement parce qu’on a déjà lu ça partout, mais surtout parce qu’en vrai, on est nombreuses à très bien l’identifier, le monstre, dès les premières pages, dans le père violent et violeur plutôt que dans sa victime au corps déformé. Je préfère proposer au cliché une alternative : le fantastique n’est pas celui qu’on croit.
L’une des protagonistes de Visqueuse est une femme dont la moitié inférieure du corps évoque une queue de poisson ou de reptile plutôt que des jambes humaines. Au fil du roman, elle sera identifiée successivement à trois créatures. D’abord la Vouivre décrite par Marcel Aymé, cette femme-serpent des marécages de l’Est au front serti d’une escarboucle, enjôleuse dangereuse pour les hommes captivés, saisie et séquestrée par Arsène, père de famille violent d’un petit village. Ensuite à la sirène imaginée par Andersen, femme-poisson nageant au milieu des dauphins d’un sinistre aquarium. Enfin à Mélusine, femme-dragon de légende chassée d’un château hors du temps, lorsque le secret de son origine est révélé. Trois identifications dont chacune est, à sa manière, fausse, mais qui nous donne à voir la déshumanisation tout à la fois des femmes, des personnes queer, des personnes handies : la métaphore peut changer, la réalité de leur déni d’humanité demeure. L’héroïne est assignée à ces identités par des hommes cyniques ou violents : Arsène, le père de famille qui la capture dans l’espoir vain d’un trésor à gagner, la torture, la viole, s’éprend d’elle ; le directeur d’aquarium qui l’exploite en profitant de l’ambivalence de son statut, laissant les dauphins du bassin la harceler et la violer eux aussi. Mais elle y est aussi renvoyée par les adjuvantes féminines qui veulent lui venir en aide : Huguette, la fille boiteuse d’Arsène, nourrie de films de la Hammer et fascinée par les freaks ; Louise Simone, nonne passionnée d’histoire naturelle qui veut décrire la malformation toute médicale qui semble avoir fusionné les jambes de la malheureuse. Même le roman ne laisse que progressivement la place à la focalisation de la créature, à mesure qu’elle parvient à glisser dans le récit ses mots, sa voix, sa conscience. Peu à peu, le roman donne la place à sa propre quête ou conquête : de liberté, d’agentivité, de vengeance, d’identité, d’humanité.
Du « monstre » folklorique ou cinématographique au « monstre » médical en passant par les « monstres » de foire et cirque, il n’y a donc guère d’écart, guère d’espace où espérer être l’humaine qui ne serait ni vouivre, ni sirène, ni Mélusine. Les deux autres protagonistes symbolisent d’ailleurs les ambivalences de la relation aux monstres. Huguette, gamine abusée et rendue boiteuse par son père, qui se reconnaît dans les créatures du cinéma d’horreur plutôt qu’à ses belles héroïnes, incarne l’identification enfantine et empathique à l’autre victime d’Arsène, l’affection pour celle dont elle partage l’impuissance. Louise Simone est mue par l’intérêt intellectuel, la force de la raison face aux superstitions et aux cynismes, mais aussi par un trouble attrait pour l’animalité. L’une comme l’autre ont aussi à conquérir un espace de liberté. L’une comme l’autre veulent aider cette sœur anguipède. L’une et l’autre merdent, diversement, dans leurs efforts. Et c’est là – dans le trouble de leur fascination, dans les cicatrices restées ouvertes du passé et de l’origine de Mélusine, dans les brumes et les ambivalences du marécage – que le fantastique se métamorphose et que le doute se glisse en nous. Il n’est pas le conte que l’on avait cru reconnaître, la réponse scientifique qui aurait terrassé la croyance, l’allégorie univoque que l’on voulait décoder. Le fantastique se réinjecte en échappant au registre de la légende pour s’enrichir de ceux de l’histoire naturelle, de la médecine, puis pour redevenir histoire que l’on transmet, que l’on déforme et que l’on grime, dont on ne sait s’il pourrait reprendre jamais l’apparence de la « norme » – comme le corps de Mélusine.

Mélanie se balade depuis pas mal d’années dans les mondes littéraires et ludiques de l’imaginaire, avec un peu de recherche universitaire sur les mythes, les âmes et les dragons, un peu d’écriture de nouvelles, et beaucoup de lecture. De temps en temps, elle en sort parce que les programmes de l’Éducation nationale exigent qu’on parle d’autre chose aux lycéen·nes. Elle est convaincue qu’il y a des milliers de trésors à partager en SF et en fantasy, et que le cocktail héros couillu, mentor barbu et récit convenu n’y est pas une fatalité.