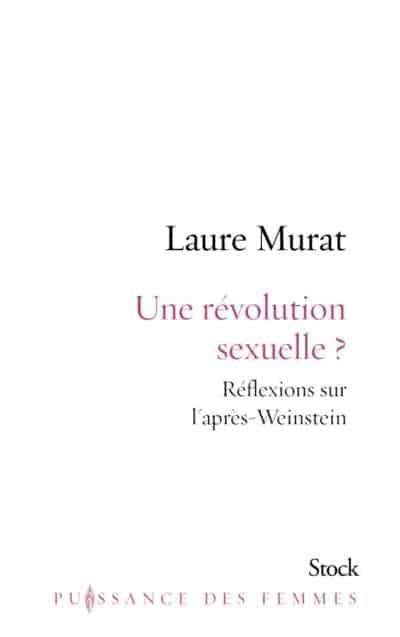En mai 2024, Mohammad Rasoulof arrive à Cannes trois jours avant le festival pour présenter son film, Les Graines du figuier sauvage. Il vient de fuir son pays et une nouvelle peine d’emprisonnement de huit ans que les ayatollahs ont prononcée contre lui lorsqu’ils ont su qu’il venait de tourner, dans la clandestinité, un nouveau film à Téhéran. Le film en question est encore plus politique que ce à quoi Rasoulof nous a jusqu’ici habitué.es. Le propos est clair et frontal, seul le titre vaut pour métaphore et aurait pu permettre de contourner la censure, mais Rasoulof ne veut plus se détourner, par le truchement des images et des analogies, de la vérité qu’il met désormais au jour dans sa brutalité : celle de l’orchestration de l’anéantissement des femmes iraniennes par le régime qui dit vouloir les protéger. Les protéger de qui, de quoi ? De l’impudeur, du « complot mondial contre l’Iran » ou encore du mode de vie occidental que les « ennemis de Dieu » tentent de faire prospérer au sein de la République islamique. Si de nombreuses archives permettent de montrer l’horreur des événements qui ont mené à l’émergence du mouvement Femme, Vie, Liberté, le tour de force de Rasoulof réside justement dans son choix d’incarner aussi le régime par la fiction, à travers une famille de petits-bourgeois cossus et idéologiquement endoctrinés : Iman, le père, Najmeh la mère et leurs feux filles, Rezvan et Sana. C’est à cette condition que le film parvient à devenir une parabole du quotidien des Iraniens – et non plus seulement une œuvre légitimement indignée – parabole où chaque membre de cette famille éclatée par le doute se rattache à un pan de la société iranienne.
À cet égard, le film pourrait faire écho à La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer, tant il fait advenir le mal dans sa banalité tantôt la plus terrible, tantôt la plus médiocre, à travers une mise en scène de l’ordinaire où perce en hors-champ l’indescriptible et l’effroi. Car le long film de Rasoulof se déroule principalement en huis clos, dans l’appartement de cette famille qui vit aux frais du régime. Les scènes de cuisine, celles de repas partagés ou encore les instants passés dans la salle de bain familiale sont autant de moment charnières qui nous en disent plus sur les personnages et leur état d’esprit que toute confrontation au réel, et que reflètent lesdites archives sans cesse accusées par le patriarche et sa femme soumise d’être de sournois simulacres qui ont pour unique ambition de faire tomber le régime idéal voulu par Allah.
Pourtant, à l’image de Cécile Ladjali tentant de retracer l’histoire de ses origines, Rezvan et Sana vont parvenir à « comprendre de mieux en mieux les choses tues »1 et vont s’emparer de leur liberté, qu’elles vont imposer à leur père. Le film politique devient alors un thriller, où chaque personnage va devoir se battre pour survivre, dans un éloge final de la praxis et de la jeunesse féminine, enfin puissante.
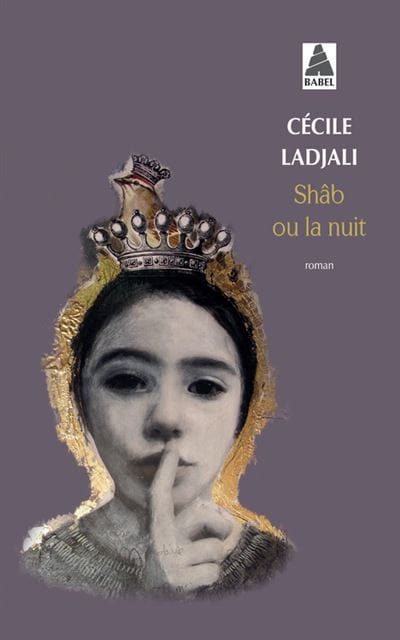
Allégorie de la situation politique iranienne contemporaine, Les Graines du figuier sauvage est de ces films dont on sort si perturbée qu’à la vue de la vie qui continue à passer, ici, dans un pays qui ne relève pas du régime totalitaire, où des femmes et des hommes dans les bars parlent, dansent et s’enivrent, dans les vêtements qu’ils et elles ont choisi, on éprouve un soulagement paradoxal, car le malheur gronde, abat des corps, torture la chair, manipule des êtres, là-bas, dans un Orient rendu si proche par le cinéma et les réseaux sociaux, pendant que nous continuons à vivre.
C’est pris par la honte que nous regardons le film et que nous haussons ses actrices, ses acteurs et son réalisateur aux rangs de héroïnes et de héros, car les bras ballants, très assurées et assurés de nos droits, en piaillant dans les rues, en nous séduisant les uns les autres, en exposant nos idées brillantes ou en tournant les pages d’un livre qu’on s’est facilement procuré, nous continuons à vivre.
Les yeux embués ou la larme franche, nous sommes évidemment du côté de cette génération de jeunes filles et de jeunes femmes qui sont agressées, meurtries, défigurées, violées, assassinées par le régime de la République islamique d’Iran, qui ont le courage de leurs opinions et que le film de Mohammad Rasoulof représente avec le génie de sa mise en scène et de son scénario. Peut-être nous couperons-nous bravement les cheveux pour clamer au monde que nous partageons leur douleur et leurs combats, mais nous continuerons à vivre.
C’est finalement le sentiment de notre indécence qui nous assaille, car nos privilèges demeurent en Iran des négociations sans fin, à l’image de celles de Sana tentant de modifier la coupe du tissu de son hijab pour montrer au monde son corps qu’elle ne veut plus dissimuler ou de celles de Najmeh suppliant son mari de ne pas tuer leurs filles qui mettent à mal son autorité de patriarche endoctriné, car les manœuvres orchestrées par les artistes pour créer des films dont nous acclamons l’ingéniosité finissent par échouer et obligent un réalisateur et ses actrices à s’exiler après avoir reçu toutes les éloges d’un monde occidental qui aime les prix sans agir, car nous nous dérobons face à la tâche qui est la nôtre, car deux ans après la mort de Mahsa Amini les mollah continuent à sévir en Iran et que c’est bien l’Occident qui les y a mis en 1979, car ici des femmes politiques qualifient le voile islamique et le hijab d’embellissement et non d’asservissement, car les iraniennes se battent en dansant et brûlent le symbole de leur oppression quotidienne, honteusement seules, pendant que nous continuons à vivre.
Alors, puisqu’ici les cinémas sont des lieux libres, puisque la liberté et l’égalité devraient se partager, puisque les femmes iraniennes doivent là-bas être libérées et que Les Graines du figuier sauvage constituent une défense magistrale de cette liberté, puisque enfin nous le pouvons : assurons à ces femmes leurs droits et aidons-les à continuer à vivre.
- Cécile Ladjali, Shâb ou la nuit, Actes Sud, coll. « Un endroit où aller », 2013, p. 287 ↩︎

Clara Shadi Nadjmaie collectionne les denim, accumule les éditions du Voyage au bout de la nuit, et ne cesse de s’éblouir du lyrisme de Forough Farrokzad. Elle aimerait partager un thé avec Abbas Kiarostami et voir de ses yeux la bibliothèque de Florence Aubenas. Ecouter avec indiscrétion les conversations des femmes au café, regarder trois films d’affilée au cinéma et entendre les « ahhhhh » de ses élèves qui comprennent enfin ce qu’elle essaie de leur transmettre comptent parmi ses activités favorites. Si elle passe la majorité de ses week-ends à la critique sardonique de la presse et à l’inspection obsessionnelle des rayonnages des librairies, ses semaines sont dédiées à l’invention de dictées et autres facéties de l’enseignement secondaire.