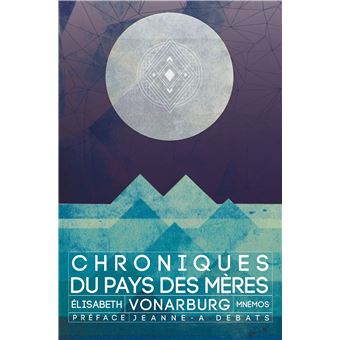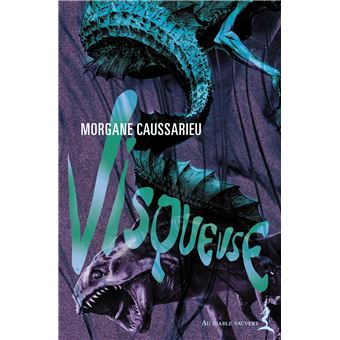Je m’étais promis, en commençant à chroniquer sur Missives, d’y mettre en avant les œuvres écrites par des autrices en SFFF (science-fiction, fantasy, fantastique) qui passent au karcher les résidus sexistes, cis/hétérocentrés, mais aussi racistes et validistes qui se sont encroûtés sur un genre que je persiste à aimer de tout mon cœur malgré tout. Avec un pareil azimut, je n’ai que trop tardé à parler de Ketty Steward, alors que je pourrais assez platement me contenter d’écrire : si ce sujet vous intéresse, fermez ce billet et allez la lire, elle. Plutôt que de la gloser salement, donc, je me permettrai juste ici de proposer trois points d’entrée dans son œuvre si vous voulez en savoir plus avant de vous lancer.

Premier cas de figure : vous n’êtes pas une lectrice particulièrement branchée SFFF, vous êtes surtout en quête de lectures féministes et vous ne demandez qu’à élargir vos horizons. Mon ordonnance : son recueil de nouvelles Saletés d’hormones et autres complications (2023), qui rassemble quinze récits et autant de courts textes poétiques et constitue une excellente initiation aux questionnements dont fourmille l’écriture féministe de l’imaginaire depuis quelques décennies. Qu’a-t-elle de singulier ? D’abord, c’est une SF qui redonne une place centrale au corps. Mais le vrai corps, pas l’instrument triomphant de la conquête musclée. Le corps qui saigne et qui se demande comment planquer ses règles dans un monde où elles sont devenues aussi rarissimes qu’impossibles à cacher (« Saletés d’hormones »). Le corps qui vieillit et s’abîme, qu’il cherche à échapper à la mort programmée de sa beauté en s’offrant un clone (« Corps usagé, peu servi ») ou qu’il réclame qu’on le laisse partir en paix au lieu de le traiter comme un objet de fascination (« HeLa est là », hommage à Henrietta Lacks). Le corps malade, dépendant de traitements devenus de plus en plus difficiles à se procurer (« Lozapéridole 50 mg comprimée pelliculée »). Le corps qui s’entête à ne pas correspondre aux critères d’une perfection fantasmée, et c’est tant mieux car qu’est-ce qu’on pourrait bien apprendre d’un corps parfait (« Le Meilleur de l’Humanité »). Les poèmes font écho au rouge du sang et à la rage des souffrants. Ketty Steward s’inscrit clairement à contre-courant des fantasmes du transhumanisme et des corps parfaits et immortels qu’il rêvasse, mais d’une manière différente de ce qu’on lit souvent sous la plume d’auteurs masculins et valides qui semblent ne voir dans ces tentations que le caprice de consommateurs hédonistes gentiment décérébrés, parce qu’ils n’imaginent pas le point de vue d’un corps abîmé ou dolent. Ici, la revendication change : il s’agit de refuser le transhumanisme au nom du droit fondamental de ces corps non-valides à exister, mais selon leurs termes à eux.
Ensuite, c’est une écriture qui interroge systématiquement les rapports de domination, tout en refusant opiniâtrement de n’y jouer que le rôle auquel d’autres voudraient cantonner sa portée, d’être la porte-parole modèle de la prétendue « diversité » dans un panel de mecs blancs en mal de bonne conscience et d’incarner pour eux l’identité à laquelle ils voudraient l’assigner. On l’entend par exemple dans « Lozapéridole 50 mg comprimée pelliculée », qui fait entrer en résonance une réflexion féministe, via l’usage du Française de Roberte Larousse (féminisation systématique de tous les noms et de tous les accords), et anti-validiste, d’un point de vue tant de psychologue clinicienne que de personne souffrant de problèmes médicaux. Dans « Le Meilleur de l’Humanité » et « Blanche-neige et le triangle quelconque », qui battent en brèche les fantasmes de l’humain-par-défaut parfait et ses préjugés racistes – les projets eugénistes sont voués à l’échec, parce que cet humanité-là n’est pas viable et n’a rien à nous apprendre. Ou dans « Mère suffisamment bonne » et « Le Souffle », deux textes sur la maternité défaillante, qui interrogent respectivement infanticide et parricide.
Deuxième option : vous êtes déjà accointée avec le milieu (et vous brûlez de tout casser). Je vous souhaite de sortir aussi inspirée que je l’ai été à la lecture de son essai Le futur au pluriel : réparer la science-fiction (2023), une démo magistrale que je m’en voudrais de paraphraser paresseusement. Je voudrais juste teaser un peu, en évoquant la métaphore qui sert de colonne vertébrale à sa réflexion, et que je trouve géniale : Ketty Steward s’est appuyée sur son travail de psychologue clinicienne intéressée par la mise en récit de soi pour diagnostiquer la dépression de la SFFF française et de son Fandom – un vieux mec prisonnier de son propre récit, celui des « grands noms » incontournables et figés dans la graisse, qui aurait bien besoin d’arrêter de ressasser et de radoter mais qui n’y arrivera pas sans un coup de main. Elle invite à faire entendre la pluralité des voix dans le milieu, comme elle le fait dans ses nouvelles, et invite d’autres auteurices à parler avec elle (de chouettes textes de Catherine Dufour, Li-Cam, Léo Henry, et de plusieurs collectifs, plus une super biblio de départ). C’est fun, ça brocarde plein de monde et ça défoule, mais ça tente toujours d’agrandir la table et de faire de la place pour que tout le monde s’y retrouve. Bref, Steward invite la SFFF à être à la hauteur de son propre imaginaire d’univers infinis et d’exploration enthousiaste de possibles innombrables.
Enfin, un troisième point d’entrée, peut-être le plus déconcertant – et pourtant… L’Évangile selon Myriam (2021) se présente comme le guide spirituel rédigé pour sa communauté post-apocalyptique par une toute jeune femme qui ne dispose, pour sa mission, que de bribes de textes conservés de « notre » monde. Alors elle combine, cite, réécrit et tâche de faire sens en reprenant extraits bibliques, tronçons de mythes et de contes, citations de Kundera et de Michael Jackson. Elle explore une écriture de la citation et de son détournement, déjà expérimentée dans ses nouvelles, et qui rappelle des pratiques littéraires comme celle du plagiat féministe et queer façon Kathy Acker : plutôt que d’enterrer les textes, leur donner une vie nouvelle en se les accaparant ostensiblement. Je trouve qu’il y a une formidable espérance, en ces temps de crépuscule permanent de nos idoles croulantes, à s’octroyer le droit de piller dans la joie ce qu’on veut chez elleux, d’en faire du matériau nouveau, du substrat pour nos créations et nos imaginaires. C’est beau de croire au choc des textes et aux étincelles qui peuvent jaillir si on veut bien les frotter les uns aux autres plutôt que de les laisser prendre la poussière dans les musées ou se morfondre dans les poubelles.

Mélanie se balade depuis pas mal d’années dans les mondes littéraires et ludiques de l’imaginaire, avec un peu de recherche universitaire sur les mythes, les âmes et les dragons, un peu d’écriture de nouvelles, et beaucoup de lecture. De temps en temps, elle en sort parce que les programmes de l’Éducation nationale exigent qu’on parle d’autre chose aux lycéen·nes. Elle est convaincue qu’il y a des milliers de trésors à partager en SF et en fantasy, et que le cocktail héros couillu, mentor barbu et récit convenu n’y est pas une fatalité.