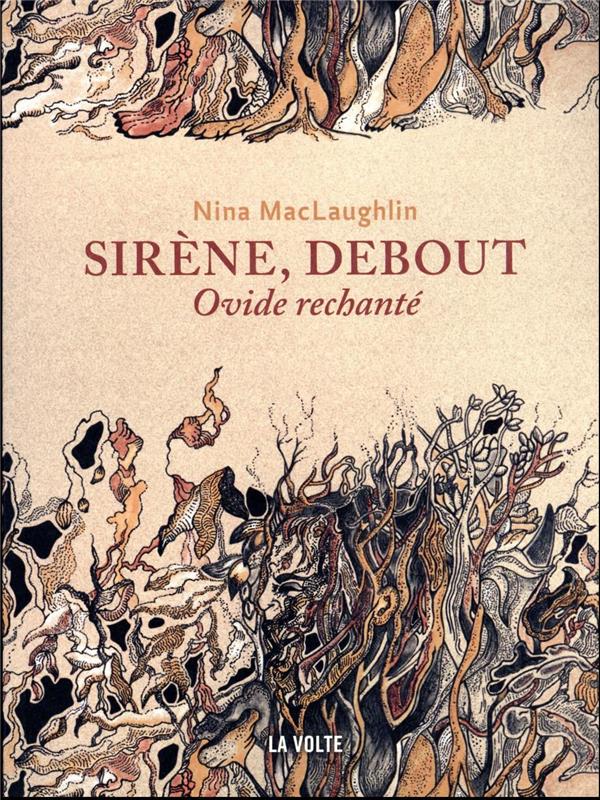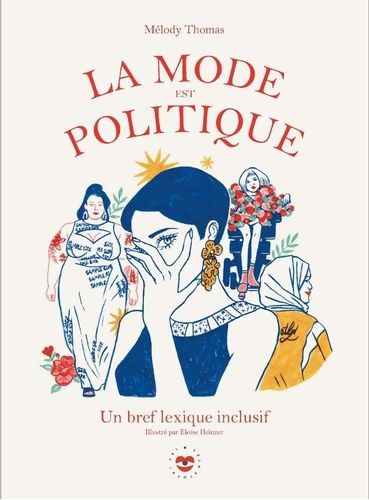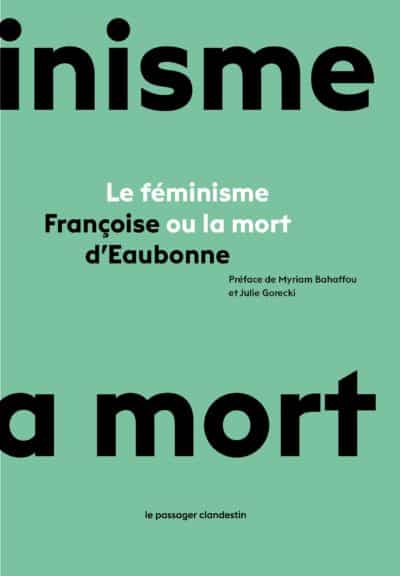Il vient un moment dans la vie d’une féministe née dans les années 80-90 où elle se prend à regarder mélancoliquement son DVD d’Arizona Dream, de La Belle et la Bête ou de Breaking the Waves en se demandant : attends, heu, est-ce que je peux encore aimer ça ?
En comprenant ce que j’ai compris ? En sachant ce que j’ai appris ?
Ce à quoi je répondrai : une de mes œuvres fondatrices, c’est les Métamorphoses d’Ovide, alors vos petits problèmes, hein.

Les Métamorphoses. Ce gigantesque poème latin qui rebrasse toute la mythologie antique pour en feuilleter chaque transformation, chaque divinité, chaque homme ou femme changée en animal, en plante, en rocher, en source, en constellation, en un autre humain, en un souffle, en moins ou plus encore – promis j’essaie de garder sous contrôle la prof de lettres classiques en moi. Ce pilier fondateur de la poésie occidentale. Et de la culture du viol. Pas si étonnant, quand on y pense : les mythes ont tendance à remplacer « Il était une fois » par « Zeus couche avec une mortelle sans trop son consentement. » Ovide ajoute à ça une érotisation évidente de ce non-consentement, une esthétisation de ces métamorphoses subies, seul moyen pour celles qui fuient d’espérer échapper à leurs agresseurs. Tu peux pas y couper, mais tu peux devenir un arbre.
Et moi, étudiante, quand j’ai lu les Métamorphoses, je n’avais pas l’armature conceptuelle féministe nécessaire pour traduire et comprendre ça : cet enracinement du poème dans la culture du viol. Je me suis fascinée pour la beauté des corps qui changent, l’évocation de l’instant où ça bascule et où la main devient branche, pour le génie de la construction narrative, pour l’émerveillement de ce monde bruissant d’âmes dans tous ses recoins. Puis la réflexion féministe a fait son chemin en moi et
…. oooohhhhhhh.
Qu’est-ce que j’en fais, alors, de mon Ovide ? Je le crame ? Je l’enseigne ? Je le cancel ?
Et puis Nina MacLaughlin est arrivée dans mon existence et elle a dit : on le rechante.
Elle n’est pas la première à donner enfin voix aux héroïnes de la mythologie. Margaret Atwood a fait parler Pénélope, Ursula Le Guin Lavinia, Madeline Miller Circé… Mais celles-ci vivaient dans des épopées, et elles avaient plein de choses à raconter. Peu de plumes s’étaient occupées de celles qui n’ont rien d’autre à dire que le viol dont elles ont été victimes, parce qu’après ce viol elles ne sont même plus humaines. Littéralement. Sirène, debout leur rend la voix, en trente textes autonomes. Et c’est fabuleux.
Il y a de la modernisation à l’œuvre, quand Alcmène devient la femme enceinte un peu reloue qui babille sur sa grossesse, quand Polyphème spamme Galatée de mails non sollicités comme un gros forceur, quand les Enfers d’Eurydice deviennent le club où elle préfère rester plutôt que de suivre Orphée dans une relation toxique. Mais ces éléments ne gomment jamais la nature magique des phénomènes : pas de rationalisation de l’existence des dieux, de la vérité des métamorphoses. Si bien qu’on n’a pas seulement l’impression de lire une réécriture. On re-lit Ovide, comme jamais on ne l’avait lu. On ré-entend son texte, mais dit par les voix des femmes.
Il y a des textes légers et doux, quelques couples vieillissants et heureux, Pomone ou Baucis. Il y a des textes atroces de violence – faites un peu gaffe si vous ne connaissez pas déjà l’histoire de Procné et Philomèle, probablement la plus horrible d’une mythologie qui ne recule pas devant la mutilation et le cannibalisme. Il y a des textes salutaires pour rappeler aux paniqués transphobes qu’au premier siècle déjà on écrivait sur celleux qui passent d’un genre à l’autre : Tirésias, Cénis, Iphis. Il y en a pour nous rappeler que les femmes aussi commettent des violences, comme Phèdre ou Salmacis. Il y a des portraits géniaux de connards misogynes, Pygmalion qui déteste tellement les femmes qu’il préfère se construire une statue froide et lisse, Apollon qui sort les pires disquettes (« J’ai inventé la médecine mais je connais aucune herbe capable de guérir la fièvre que j’éprouve pour toi »). Il y a des poèmes, des expérimentations littéraires, des dialogues et des monologues, des textes drôles, des textes bouleversants.
Et au cœur, il y a les récits de viols et de violences faites aux femmes, les plus nombreux parce qu’ils sont partout dans l’œuvre originale. Poséidon est un violeur. Apollon est un violeur. Pan est un violeur. Zeus, même si le texte d’Ovide ne le nomme jamais ainsi, est un énorme violeur. Et quand les dieux ne violent pas, ils commandent aux hommes de le faire à leur place, comme pour la néréide Thétis, parce que l’enfant qui naîtrait d’elle surpasserait son père alors autant se débarrasser via un mortel d’une pareille prophétie.
Vous allez réagir comment si j’écris que ce sont les plus remarquables scènes de viol que j’ai lues ?
Si ça vous fait hurler, je comprends. Parce qu’on nous en a vendues, des ces scènes ultra-esthétisées par un regard masculin qui jouissait des violences infligées aux femmes en se parant du bon droit de l’âââârt pour nous expliquer, si on détournait le regard : « mais atteeeeeends tu voix bien que l’œuvre condaaaaaamne ce genre de choses, ce qui compte c’est la réalisation c’est tellement ARTISTIQUE » pendant qu’on allait gerber dans un coin. Et parce qu’on en a lu, des scènes écrites par des femmes, par nos sœurs, collées à du vécu, insoutenables de sincérité, nécessaires évidemment, mais belles, non, comment est-ce qu’on oserait même penser le mot.
Ici ce n’est ni l’un ni l’autre. C’est écrit du dedans, avec zéro patience pour les justifications des perpétrateurs ; du dedans mais d’ailleurs, d’un monde où la métamorphose n’est pas seulement une métaphore de la sidération ou de la dissociation (même si elle fonctionne aussi comme ça) mais une vérité poétique.
Io qui raconte, elle dont le texte ovidien ne dit jamais qu’elle est victime :
Je suis une fille. Je m’appelle Io. Je dis non merci, pas moi, arrêtez s’il vous plaît. Mais d’un seul coup, les mots n’ont plus d’importance. Je n’ai plus d’importance.
Je suis : debout contre un arbre. Par terre. Sur le ventre. Fendue. Tout son corps sur le mien. Le mot est trop petit, trop connu, trop dompté pour ce qui s’est produit. Et ce n’était que le début, de toute façon. (…)
Mes mots n’avaient aucun pouvoir. Je parlais la langue des bêtes. J’étais incapable de me faire comprendre. Je n’étais plus cet être pleinement humain qui m’était familier, l’amie de Linda, Daniel et Quinn, qui aimait le raisin quand elle était enfant, et détestait les chaussettes, qui dessinait des châteaux et des tigres, qui rit quand on fait des rimes. (…) D’un seul coup, tout ça a disparu et j’étais un corps, une entrée, un moyen. (…)
La femme de Jupiter savait ce qu’était son époux – si ce n’est qu’au lieu de dire : Mon époux est un violeur, elle disait : Mon époux se laisse facilement tenter et cède à ses désirs, et elle en voulait aux tentatrices d’exister. (…) Jupiter ne voulait pas du courroux de sa femme, il ne voulait pas la blesser. Donc ce lâche m’a changée en vache.
Il avait déjà fait de moi une bête.
(Pardon, c’est déjà long, et je m’en veux quand même d’avoir autant coupé !)
Voilà comment je veux, maintenant, relire Ovide. Debout et réveillée, comme l’invite le titre, en anglais Wake, siren (d’où mon calembour à la Libé dans le titre). Et rechanté. Voilà ce qu’on peut faire, j’espère, de ces œuvres qui nous piquent le cœur et nous tiraillent entre l’amour qu’on leur a porté et la lucidité avec laquelle on a réappris à les regarder. Pas les cancel : les rechanter, de nos voix et de celles de nos sœurs.

Mélanie se balade depuis pas mal d’années dans les mondes littéraires et ludiques de l’imaginaire, avec un peu de recherche universitaire sur les mythes, les âmes et les dragons, un peu d’écriture de nouvelles, et beaucoup de lecture. De temps en temps, elle en sort parce que les programmes de l’Éducation nationale exigent qu’on parle d’autre chose aux lycéen·nes. Elle est convaincue qu’il y a des milliers de trésors à partager en SF et en fantasy, et que le cocktail héros couillu, mentor barbu et récit convenu n’y est pas une fatalité.