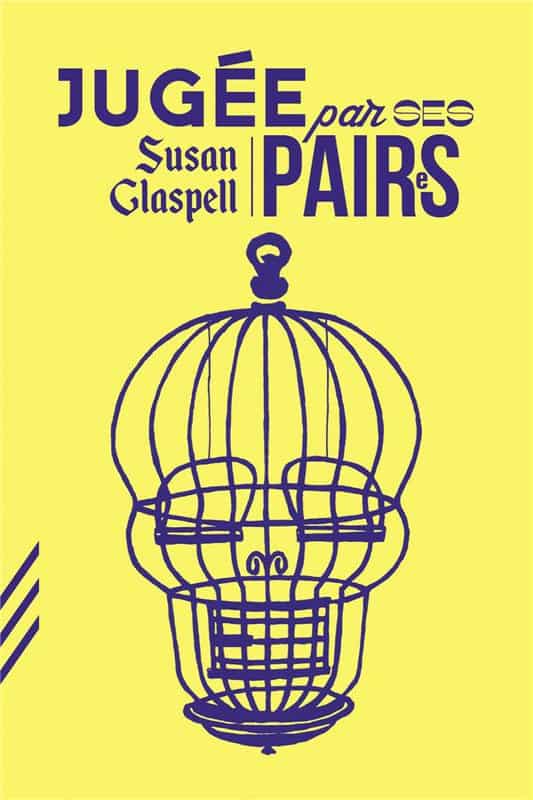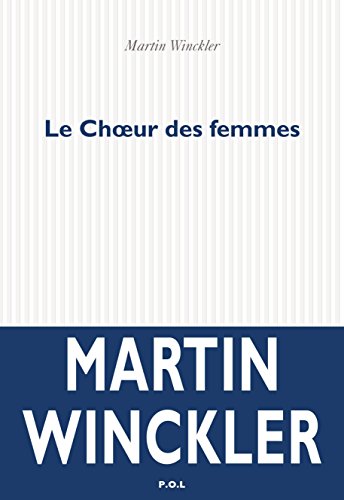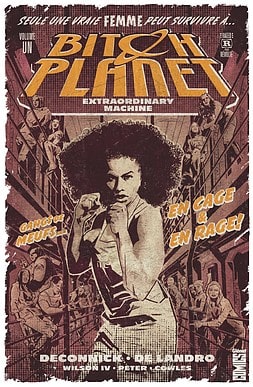Après deux ans d’attente intenable pour nos esprits avides de terres en friches à déchiffrer, la maison d’édition Tendance Négative nous revient avec un bijou de roman policier à la sauce féministe en format carnet d’enquête dont les pages se tournent vers le haut ! A nous de mener l’investigation, crayon en main.
Rencontre vendredi 19 mai à 19h30 chez Libertalia avec Tendance Négative et Irene.
Jugée par ses paires de Susan Glaspell envoie du jaune canari sur la chaux des murs de la ferme où John Wright a été retrouvé étranglé. Sa femme, mise aux fers, moisit en ville pendant que le témoin, le shérif, et le procureur, flanqués de leurs épouses, passent au peigne fin la maison à la recherche de l’indice qui inculpera de façon irrémédiable l’accusée, Minnie Foster, qu’on ne verra jamais apparaître dans ce huis-clos feutré faits de murmures et de regards pleins de sous-entendus. Deux espaces, le rez-de-chaussée et l’étage, deux sociétés, celle des hommes et celle des femmes, deux regards, l’un aveugle, l’autre clairvoyant, tout s’entrechoque dans ce roman puissant.
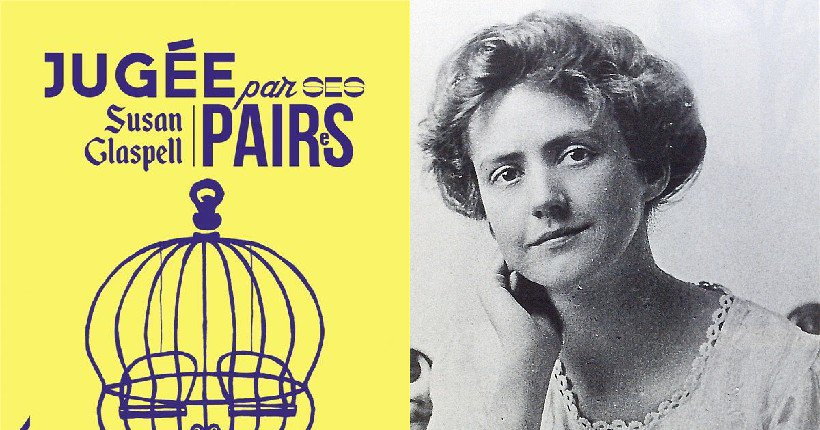
Du fait divers à la nouvelle policière
La modernité de ce texte de 1916 est lié au dynamisme de l’écriture de la nouvelle, car l’autrice Susan Glaspell, par sa formation , passe de l’écriture d’articles de faits divers pour la presse à la dramaturgie avec aisance. Cette histoire de meurtre a en effet été revisitée sous différentes formes par Susan Glaspell à divers moments de sa carrière de graphomane. Alors qu’elle était encore journaliste en 1900, elle publie une série de 26 articles pour couvrir l’homicide de John Hussack un fermier de 59 ans, assassiné par sa femme Margaret Hussack. Fortement impressionnée par le portrait glaçant qu’on dresse de la meurtrière, Susan Glaspell se lance dans une investigation soucieuse de rétablir l’humanité de Margaret et dévoile les maltraitances chroniques dont elle avait été victime, éclairant d’un jour nouveau le meurtre sur fond de violence domestique. Les 46 pages de cette nouvelle adaptée de la pièce de théâtre que Susan Glaspell avait initialement écrite pour son collectif Provincetown Players sont profondément marquées par l’engagement féministe de cette autrice, sensible aux conditions de vie de ses contemporaines et aux dominations qui pèsent sur leur voix et leur corps.
« Des machins de cuisine »
Animée par ailleurs du désir de renouveler l’écriture dramaturgique du début du XXe siècle, elle déplace habilement le cadre de l’enquête traditionnelle et pousse le projecteur sur la zone d’ombre dont tout le monde se désintéresse habituellement. Bien que ce soient les hommes, boursouflés de vanité et de suffisance, qui mènent la perquisition chez Minnie Foster, inculpée pour le meurtre de son mari, ils sont vite évacués de façon ironique par l’instance narrative. Après le récit du témoin Lewis Hale qui a découvert le corps, ils s’empressent de filer à l’étage sur la scène du crime ignorant royalement du même coup les femmes qui les ont accompagnés et les discrets indices de l’enquête disséminés dans la pièce du bas. Ils passent régulièrement comme des oiseaux insignifiants et moqueurs dans la cuisine où les deux épouses Martha Hale et Madame Peters se tiennent compagnie ; circulez, rien à voir, les pièces à conviction ne sont pas visibles pour leur regard masculin : ils cherchent du spectaculaire et de l’évidence là où c’est la finesse et l’expérience de l’humilité d’une vie soumise qui éclairent le sens des choses :
Chacun remue. Le procureur du comté avance vers la porte qui mène à l’étage.
« Je présume qu’on ira d’abord en haut,
puis dehors du côté de la grange. »
Il marque une pause et parcourt la cuisine des yeux.
Il demande au shérif :
« Vous êtes certain qu’il n’y a rien d’important ici ? Rien qui pourrait indiquer un mobile ? »
Le shérif regarde à son tour,
comme pour se convaincre à nouveau.
« Y a rien d’autre ici que des machins de cuisine » dit-il avec un petit rire pour en souligner toute l’insignifiance.
Sauf que la cuisine, lieu de l’enfermement domestique, de la corvée et de la solitude féminine dans la vie rurale du début du siècle passé, est la clé qui ouvre la chambre des secrets de la vie de Minnie Foster. Les femmes savent, elles voient au travers des objets, à la façon dont le morceau de quilt est cousu, à la manière dont le sac de sucre n’est pas rangé, à la porte de la cage abîmée, elles lisent les gestes de l’absente et même ses pensées, les émotions qui ont pu l’étreindre à partager l’intimité d’un mari violent et menaçant. A pas lents, Martha Hale et Madame Peters reconstruisent l’épaisseur de la vie de Minnie Foster. Une vie brisée, une jeunesse envolée loin des chants légers de l’insouciance.
A chacun.e sa police, à chacun.e sa justice
Connue pour ses prises de position éditoriale audacieuse, la maison d’édition Tendance Négative opte pour un papier jaune canari, comme l’oiseau au coeur de la nouvelle policière, symbole de liberté encagée, et pour une encre bleutée d’une rare élégance. Mais on retient surtout l’idée que chaque personnage endosse sa propre police de caractère : « Police partout, Arial nulle part ! » comme il est écrit en début de livre. Minnie dont la voix est inaudible a son nom écrit en tout petits caractères ; les femmes négligées, minorées, occupent leur typographie à mesure qu’elles prennent de l’importance dans le texte, mais restent cantonnées à des ronds et des déliés attendus de leur sexe. Clin d’oeil à l’esthétique western, le shérif s’exprime dans une police de saloon, lourde d’images de chique à la bouche et de senteurs de crottin de cheval. Hale, le témoin, pauvre bougre mal dégrossi, est affublé de caractères ordinaires, sans personnalité, de taille inférieure à ceux du procureur ou du shérif qui sont des hommes de pouvoir. La typographie se veut donc le reflet des stéréotypes et des rapports de force qui structurent la société américaine de l’époque. Mais police et justice ne sont pas toujours en accord et quand l’autorité est sourde et aveugle, la seule justice qui peut avoir lieu se fait en dehors de la loi, à l’écart des mots échangés, dans les regards discrets et les gestes qui dérobent aux yeux scrutateurs des hommes les preuves de la culpabilité de Minnie Foster ; condamnée avant d’avoir pu parler, parce que femme, parce que criminelle, l’accusée voit son témoignage passer sous silence, sa police réduite à son seul nom, dernière existence légale avant sa disparition de la société civile.
Voir et « Pairecevoir »
Cette première traduction française d’une autrice majeure aux États-Unis contribue à élargir notre connaissance de la littérature féministe anglo-saxone et à moderniser un texte vieux de cent ans. On vire le passé simple équivalent du prétérit anglais pour un présent qui ancre le récit dans une actualité toujours tristement moderne que sont les violences faites aux femmes et on plonge ainsi dans l’intimité de l’enquête aux côtés des personnages.
Néanmoins, le travail de l’autrice traductrice Marine Boutroue qui avait déjà oeuvré auprès de Florian Targa pour la traduction du Papier peint jaune de Charlotte Perkins Gilman en 2020 ne s’arrête pas à ce balayage temporel. Elle enrichit le texte d’une dimension féministe renouvelée. Ajouts d’expression sexistes ordinaires, lexique de la domination masculine, mise en suspens des phrases des femmes qui censurent leurs pensées, habituées à s’exprimer tel qu’on attend d’elles qu’elles le fassent. Marine Boutroue explique qu’elle a supprimé les « dit-elle/dit-il » pour une mise en page plus fluide, plus proche de l’écriture théâtrale, des indications de mise en scène et de la prévalence donné au dialogue entre les deux femmes, vrai moteur de l’action. Du « on » indifférencié au « nous » collectif de la solidarité féminine, la traduction rend le chemin de conscience des personnages qui comprennent plus finement le mobile du meurtre en même temps qu’elles développent une complicité pour échapper à l’insignifiance dans laquelle les hommes les relèguent. Complicité des enquêtrices qui s’appuient l’une sur l’autre pour avancer dans leur enquête, pour « pairecer » la vérité sous les apparences et les empêchements à penser, mais aussi complicité avec l’accusée Minnie Foster puisqu’en prenant place dans son fauteuil, en manipulant son tablier, en cousant les mêmes pièces de tissu assemblées en quilt, en observant les pots de cerise qu’elle a mis en conserve, Madame Hale et Mme Peters deviennent Minnie Foster et lui donnent l’occasion de se défendre sans user de mots. Tour à tour, voisines, amies, enquêtrices, et juges, elles innocentent celle qu’elles auraient dû aider à se libérer d’une vie misérable:
Madame Hale examine les vêtements que la femme détenue en ville avait demandés.
« Wright était pingre ! »
Elle a dans les mains une jupe noire qui porte les stigmates de nombreux rapiéçages.
« C’est peut-être pour ça qu’elle se tenait à l’écart. J’imagine qu’elle avait l’impression de ne pas savoir faire ce qu’il faut, et puis on ne profite pas quand on se sent pouilleuse. Avant, elle portait de jolis vêtements et elle était pleine de vie – quand elle était Minnie Foster, une fille de la ville, et qu’elle chantait dans le choeur. Mais ça, oh, c’était il y a vingt ans. »
Avec une délicatesse teintée de tendresse, elle plie les frusques et les empile sur un coin de la table.
Qui aura la corde au cou ?
Et d’un geste remarquable de tendresse la culpabilité change de camp : si elles lui avaient rendu visite, si elles avaient pris conscience à temps que les liens collectifs sauvent de l’isolement et de l’état de vulnérabilité aux pires violences, Minnie Foster serait toujours dans la communauté et ne serait pas accusée de meurtre.
En réalité la vraie culpabilité incombe aux absents, qui évoluent dans les rires et la satisfaction de leurs rôles d’oppresseurs. Ceux qui continuent d’aller et venir aveuglément dans et hors de la maison, certains que le monde leur appartient et que les femmes n’en sont que des accessoires dédiés au mieux à leur plaisir, au pire à leurs emportements tyranniques. Pourtant, sur fond de glousserie des hommes, les femmes ont déjoué le mystère, elles ont assemblé les morceaux et fini de nouer ensemble les indices, comme Minnie Foster assemblait ses pièces de tissu pour supporter son quotidien. Et elles ont donné un dernier tour de corde, et tiré un bon coup autour du cou du patriarcat.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.