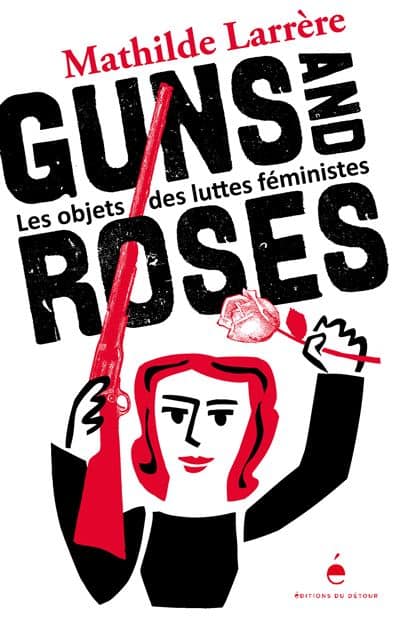Militante aux multiples visages (notamment pour le collectif Voix Déterres), chercheuse en philosophie et études de genre, Myriam Bahaffou s’intéresse à notre façon de modeler l’écoféminisme à notre image. Largement récupéré par l’industrie marchande qui aime digérer les discours les plus subversifs pour les rendre inoffensifs et donc assimilables par l’organisme social, l’écoféminisme n’a pas été épargné par ce phénomène de domestication assez courant somme toute. Discours confisqué aussi par une bourgeoisie blanche qui s’échange des astuces sur les couches lavables et nous incite à faire pipi sous la douche pour protéger la planète, l’écoféminisme a sérieusement besoin d’être pensé dans une perspective décoloniale, dépoussiéré de ses vieilles antiennes.

Avec son essai Des paillettes sur le compost, publié au Passager clandestin en octobre 2022, Myriam Bahaffou prend la tête de la visite guidée du grand supermarché féministe et nous mène au rayon écoféministe où les produits sont bien étiquetés et bien rangés sur les étagères mais nous laissent sans envie. Son écoféminisme à elle est à chercher dans la réserve dont elle a fracturé la porte depuis longtemps. Suivons-la à travers les rayonnages bariolés de ses chapitres en forme de maximes, « A force de vouloir briser les plafonds de verre, on se tranche les veines », aux titres racoleurs, « On fait l’intégral et l’interfessier ? », ou qui jouent avec l’absurde comme avec la longueur, « Le jour où j’ai découvert que mon chat avait un menton ou pourquoi les écoféminismes sont antihumanistes ». Le programme promet d’être alléchant !
La liberté comme art poétique
Myriam Bahaffou n’appartient pas à la trempe de celles qui s’excusent d’être des « rabat-joie ». De cette tonalité, elle se fait même une esthétique qui siffle la fin de la récré, invitant celles qui lui ressemblent à venir à sa rencontre pour former une grande communauté de trouble-fête, déterminées à mettre des coups de pied dans toutes les idées prêtes à l’emploi qui permettent de tourner en rond. L’écoféminisme n’est pas sympathique, il ne promet pas un doux chemin plat sans embûches qu’on parcourrait en se donnant la main dans l’harmonie universelle. Le texte foisonne de références, citations qui donnent de multiples éclairages au propos de l’autrice dont les bibliographies en fin de chapitre offrent la possibilité d’aller plus loin sur chaque thème abordé.
Pour un écoféminisme anticapitaliste et décolonial
Pour elle, penser l’écoféminisme débute avec la question de l’identité ; si nos discours nous ressemblent, commençons par comprendre qui sont celleux qui en sont à la source. A l’origine, il y a la honte d’être celle qu’elle est, une fille d’émigré.es. Myriam Bahaffou raconte ses efforts démesurés pour performer la classe à laquelle elle aspire tant, celle d’une bourgeoisie intellectuelle à qui tout réussit. Lors d’une descente de train à Genève sous les yeux fascinés de son amoureux, scène digne d’un classique cinématographique d’un autre temps, elle admet connaître le délice de se sentir toute puissante, d’avoir joui d’une identité longtemps désirée, volée pour un temps illusoire aux puissant.es de ce monde :
Au moment de me lever, j’aperçois mon reflet sur la vitre. Je porte un haut au décolleté démesuré, un pantalon large qui rappelle le style très sérieux des femmes cheffes d’entreprise, et j’ai sur le nez d’énormes lunettes de soleil, de celles que pourrait porter Eddie Britt dans un épisode de Desperate Housewives. J’attrape ma valise, m’extirpe de la file, pose un pied hors du train et rejoins la gare d’une démarche digne d’un défilé de RuPaul’s Drag race. J’avance sur le quai en balayant le monde du regard à travers ces lunettes et sens mon corps se mouvoir avec une assurance incroyable, tout en rythme et en cadence : ma taille, mes seins, les talons qui claquent le sol, tout est parfaitement aligné et synchronisé.
Le fantasme de la « cheffe d’entreprise » en dit long sur le désir de s’extraire de sa classe sociale et d’éradiquer toute trace de pauvreté par la multiplication des signes d’appartenance à une bourgeoisie libérale (jeunesse, corps souple, accessoires de mode, culture américaine). Cette performance élevée au rang d’art s’applique à voiler l’identité de classe qui pourtant ne s’efface pas comme nous l’ont montré les travaux des Pinçon Charlot. Ce constat indépassable invite donc l’autrice à inclure l’identité de classe dans sa réflexion sur l’écoféminisme : plutôt que de chercher à dissimuler son origine honteuse à ses yeux, elle va la transformer en levier politique, en terreau de son engagement. De la même manière que l’écoféminisme ne descend pas de l’Olympe des dieux, elle prend ses racines chez les plus pauvres de ce monde. Elle prend conscience que l’écoféminisme a une vie avant d’être incarné par des milieux militants bourgeois blancs qui l’ont théorisé en oubliant son fondement premier. Ce mot « écoféminisme », il faut l’arracher à la sclérose qui guette, hijacker les beaux discours pour semer le trouble en terres écoféministes, en rappelant notamment que ce mouvement n’a pas à rougir de ses origines populaires :
Malgré l’injonction à l’individualisme que j’ai reçue depuis toute petite, […] j’ai toujours grandi dans des espaces où les gens étaient nombreux, dans ma famille, dans mon quartier, dans mon école. les mobilisations collectives, les gardes alternées avec d’autres mamans, les réseaux de soutien, les partages de nourriture faisaient partie du quotidien. Nous n’avons pas attendu le monde militant alternatif et anticapitaliste pour nous introduire aux enjeux de la vie communautaire.
Ce que Geneviève Pruvost, citée par Myriam Bahaffou, nomme « écoféminisme de subsistance » permet de retourner la honte que ressent l’autrice en un puissant moteur de transformation politique. Ces solidarités nécessaires sont d’abord la preuve que les personnes qui vivent cet écoféminisme de subsistance ont été « appauvries » par un système et qu’il faut neutraliser en priorité les inégalités sociales.
Myriam Bahaffou aime se frotter à la contradiction, assume le fait d’être une « bad feminist » comme Roxane Gay le clamait. Certes, elle fréquente les salons de beauté de Saint Denis avec la culpabilité de se soumettre à une injonction esthétique sur son corps, s’astreint à rejoindre l’idéal intouchable de la féminité. Mais elle côtoie aussi des lieux non mixtes dans lesquels la parole n’a pas la même saveur que dans la vie civile, et où s’élabore une beauté choisie, car personne n’est dupe : la beauté « naturelle » est une illusion tout juste bonne à être associée à celle du féminin blanc universel. Apprendre à aimer son corps dans des espaces où on construit sa féminité selon ses goûts permet de complexifier le regard d’un féminisme qui s’empresse de dénoncer la superficialité du recours aux cosmétiques et exprime son mépris envers les praticiennes des salons, souvent issues de classes sociales précarisées. Ainsi, le chapitre « On fait l’intégral ou l’interfessier ? » résonne ici parfaitement avec le superbe livre de Nathalie Kaïd S’aimer tatouée chroniqué sur Missives.
En finir avec l’humanisme
Un tête à tête avec son chat Jorge et l’autrice plonge aussitôt dans des abîmes de réflexions sur notre soi-disant statut exceptionnel, sur notre humanité si essentielle et si supérieure et sur la prétendue vacuité des âmes animales dont plusieurs siècles de philosophie mécaniste nous ont convaincu.es. Sur fond de ronronnements félins, Derrida surgit et, avec lui, une foule de penseurs Fahim Amir, Florence Burgat ou Nicolas Bancel ; le soupçon que la binarité humain/non humain est une vaste fumisterie et qu’elle est inopérante pour penser le vivant tombe comme un couperet. Le mythe du 16e siècle de l’Homme « mesure de toute chose » a surtout contribué à justifier des discours oppressifs et coloniaux, de sorte que Myriam Bahaffou ose des analogies entre catégories animales, handicapées, corps marginalisés, peuples dominés et pointe du doigt la satisfaction d’un projet colonial : autant victimes que résistantes, ces catégories ont subi des mécanismes similaires d’exploitation et de mise à mort pour satisfaire un agenda politique. Le parallèle entre zoos humains, freak shows et zoos animaux est à ce titre glaçant :
Objet largement sous-évalué dans la discussion animaliste, ces zoos humains sont le parfait exemple de cette humanité à géométrie variable, qui doit sans cesse animaliser un « autre », « importé, exhibé, mesuré, montré, disséqué, spectacularisé, scénographié », selon les attente d’un Occident en quête de certitudes sur son rôle de « guide du monde », de « civilisation supérieure ».
Comment ne pas voir dans ces êtres vivants les alliés parfaits de celles et ceux qui subirent une violence systémique raciste ? Dénoncer cette domination redonne au corps opprimé le droit à la parole dans le champ écoféministe lui aussi dominé par des corps blancs. Même à Bure, l’un des lieux les plus engagés de la lutte antinucléaire actuel, prendre la parole comme femme non blanche relève du geste politique, alors même que cette parole devrait être au premier plan :
De fait, ce sont les femmes africaines, indiennes ou argentines qui ont expérimenté en premier le croisement entre genre et natures. Concrètement, ce sont elles qui ont compris la continuité entre travail domestique et travail de la terre. La place de ces femmes n’était pas un destin, mais plutôt un levier de pouvoir pour faire évoluer ces structures, tout en refusant l’émancipation au prix d’une masculinisation du monde. Ce sont elles qui ont appris à résister aux envahisseurs coloniaux qui, à coups de pesticides, d’extractivisme et de violences sexuelles, s’approprient ces corps qui comptent.
Ecoféminisme décolonial : une utopie ? article de Myriam Bahaffou
Faire de la salope une figure politique
Après les sujets qui piquent, place à une ouverture réjouissante sur le monde du plaisir. Myriam Bahaffou revisite la sexualité assumée et exacerbée pour la dévêtir de ses atours réactionnaires (tu aime baiser, t’es une pute !) et la laisse à poil dans sa crudité révolutionnaire. Aimer le sexe, tourner ses gestes vers l’érotisme, incarner la puissance vitale sous toutes ses formes pour contrer un imaginaire oppressif et colonial mortifère, voilà un acte politique écoféministe. Puisque l’érotisme est lien à l’autre, il devient une manière de faire monde. Et de faire monde dans toute son impureté, n’en déplaise à certains discours qui voudraient faire de la sexualité féministe un lieu fade, réduit à l’obsession du consentement où les sexualités déviantes tombent sous le coup de l’immoralité. On pourra donc brandir la sexualité comme dissidence à l’ordre établi en la dégageant de tout carcan normatif :
A rebours d’un écoféminisme de la pureté, de l’harmonie et du naturel, voyons ce que le projet éropolitique apporterait : revenir à nos corps. Sentir, vibrer, embrasser, mouiller, bander, apprendre de nos univers sexuels respectifs, en parler à table, en rire, beaucoup. […] Je n’ai pas envie de militer avec vous s’il n’y a pas de salopes dans nos rangs. car comment promouvoir un lien au vivant débordant, organique, joyeux, en mettant de côté le sexe !
Il est temps de comprendre l’écoféminisme comme une ode à la puissance réprimée du sexe et à son déchainement social. Les salopes d’aujourd’hui sont bien les sorcières d’hier !
La figure de la salope est celle de la salissure, elle devient métaphore de l’écoféminisme dont Myriam Bahaffou tente de dessiner les contours. Personne n’est au-dessus de tout soupçon, nous incarnons imperfectiblement nos utopies avec toutes les contradictions qui nous animent : nous vivons dans un environnement ultralibéral et nous en tirons des privilèges, nous savourons notre café et prenons l’avion parfois, tandis que nous passons du temps en manifestations et dans des groupes anticapitalistes. Le profane, le vulgaire n’est pas une fuite mais une voie pour tout faire tenir ensemble. La sexualité en est une composante politique qui s’élève ainsi à une dimension spirituelle certaine.
Pour un manifeste écosexuel
L’exemple de Folleterre un peu plus loin dans l’essai permet d’entrevoir un lieu dissident où les personnes marginalisées pour leur orientation sexuelle ont trouvé refuge et y expérimentent d’autres liens : on y prend son petit-déjeuner en « robe de mariée », on prend soin des vivants, on chante, on vit sa masculinité différemment, on s’embrasse dans une forêt magnifique à l’écart du monde violent des métropoles. Myriam Bahaffou témoigne de la transformation qu’elle connait au contact de cette communauté inédite :
Elles ont permis à mon énergie extravertie, sexuelle et dramatique de se manifester, d’exister ; surtout elles m’ont appris à ne pas en avoir honte. J’ai pu me connecter à elleux précisément parce qu’iels ont préféré la joie à la pureté militante et que, fondamentalement, il ne s’agit pas d’une communauté de gens sages.
De cette façon, une sexualité pleinement vécue réenchante le monde avec des outils hors normes et fait rejaillir une spiritualité trop longtemps laissée de côté. Le manifeste écosexuel signé par Annie M. Sprinkle et Elisabeth M. Stephens ouvre à cet égard les perspectives d’une sexualité offerte à toutes et tous sans limitation de capacité, de genre, de sexualité, ou d’origine :
Nous sommes aquaphiles, terraphiles, pyrophiles et aérophiles. Nous câlinons les arbres sans complexe, nous massons la terre avec nos pieds et parlons aux plantes de manière érotique. Nous sommes adeptes des bains de minuit, adorateurices du soleil, et avons la tête dans les étoiles. Nous caressons les rochers, prenons du plaisir dans les cascades, et admirons souvent les courbes de la Terre. Nous faisons l’amour avec la Terre à travers nos sens. Nous célébrons nos points T. Et nous sommes très cochonnes.
Cochonnes, salopes, féministes fascinées par le luxe, amantes de la terre, appelons-nous comme bon nous semble. Longtemps, nous avons été rangées du côté du soin et de la complicité à la nature, mais qu’en est-il réellement ? Encore une fois la pureté de la nature féminine nous a joué des tours. Associées à l’innocence (quand nous n’étions pas des putains), les femmes ont bénéficié d’un sursis de culpabilité. Du sang sur les mains, oui. Qui peut décemment dire que nous n’avons pas pactisé avec les violences du monde ? Les hommes ne détiennent pas le monopole de l’impérialisme et de l’écocide : les femmes aussi ont assuré le repos des guerriers, participé à l’effort de guerre, reproduit les armées d’ouvriers de l’industrie capitaliste, ont été touchées par la vénalité et par le désir de violence. Sortir de la binarité hommes tueurs agents/ femmes passives spectatrices innocentes permettra dans un double geste écoféministe de redonner un pouvoir agentif aux femmes et de les rendre majeures face à leurs décisions politiques.
On vous avait prévenu.es : l’écoféminisme n’est pas un doux chemin aux parfums de miel et de jasmin…

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.