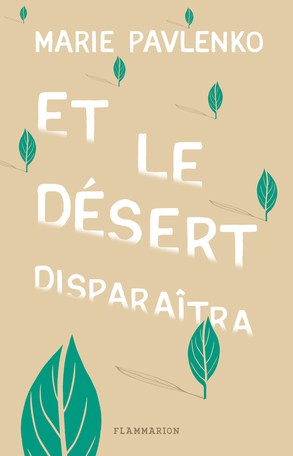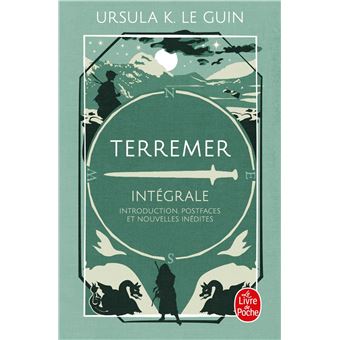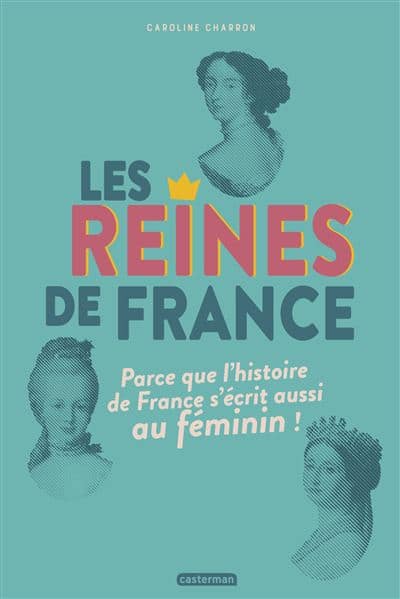Avec Et le désert disparaîtra, écrit pour la jeunesse, Marie Pavlenko interroge notre aveuglement face à la destruction programmée et acceptée du vivant. Elle nous immobilise le temps d’une lecture pour déciller nos yeux et nous inviter à l’émerveillement des trésors de la nature. Elle opte pour une fable écologique, pas si fabulante et dont la ressemblance avec les personnages que nous sommes n’est pas un hasard malheureux.

Le désert comme maison monde
Samaa et sa communauté nomade habitent l’immense étendue sableuse qu’est devenue la Terre. Dans ce temps pas si étranger au nôtre, le désert a grignoté les espaces de végétation, réduits à des oasis de chagrin, engloutissant lacs, prairies, fleurs et arbres. L’existence humaine y est laborieuse : on survit plus qu’on ne vit dans la fournaise du jour et la mort prélève son lot de vies parmi les nomades. Chaque bouche à nourrir pèse lourd quand les denrées se font rares. Lorsqu’ils atteignent un grand âge, les vieux doivent se rendre dans la Murfa une teinte noire dressée à l’écart du camp, pour y attendre d’être emportés par la mort. On repense à La balade de Narayama de Shohei Imamura qui filme ce rituel venu du Japon médiéval au coeur des montagnes de Shinshu. Si Samaa rêve de rejoindre le groupe des chasseurs de bohis (prononciation évolutive de « bois »), son malheur d’être née fille lui interdit cette voie. Seuls les hommes partent de longues semaines à travers le désert et abattent la cognée sur les troncs rares et précieux qui leur assureront une belle rente. Il s’agit d’abord de sauver la communauté et de subvenir à ses besoins essentiels, or les arbres sont les dernières ressources naturelles à monnayer aux gens de la Ville contre des barres protéinées et de l’eau gélifiée.
On serait tentée de classer ce texte dans le genre de la dystopie, un cauchemar éveillé dans lequel l’eau n’est consommée qu’en tube, où l’air appauvri en oxygène nécessite qu’on y substitue des bouteilles de gaz, et où on ne consomme que des produits ultra-transformés. Mais ce désert est-il si éloigné de nous ? Certaines régions éloignées de notre Nord ne vivent-elles pas déjà sous assistance respiratoire ? Quand il faut faire de plus en plus de kilomètres pour aller puiser l’eau ou ramasser le bois qui servira à cuire le repas, l’humaine nature ne vit pas son quotidien comme un roman d’anticipation.
Ces chasseurs de bohis qui doivent s’enfoncer toujours plus loin dans le désert à la recherche d’une trouée au fond de laquelle se cachent les derniers arbres rappellent les femmes du village de Mandal en Inde ; la raréfaction des arbres, coupés sans conscience, les obligeait à aller de plus en plus loin pour leur corvée de bois qui servaient à l’économie domestique. La comparaison s’arrête là car les pères, les frères et les oncles de la communauté de Samaa n’ont pas l’intention de préserver les arbres mais de les abattre pour en tirer profit. En 1973, les femmes de Mandal s’organisent et créent le mouvement Chipko né de l’urgence à préserver la forêt menacée par un projet de déforestation servant les intérêts économiques du gouvernement. Elles ont compris que leur survie était en péril, que le bois, énergie première de leur activités, allait leur manquer et précariser d’autant plus leur vie paysanne. Elles se sont donc mobilisées plusieurs années pour encercler les arbres, faire barrage de leur corps aux bûcherons et empêcher la coupe à blanc, condamnant irréversiblement la terre à une désertification du sol. Derrière les pages de Et le désert disparaîtra, on ne peut que voir en transparence les images de ce mouvement, revendiqué par l’écoféminisme comme un modèle de résistance à la domination des hommes sur la nature.

Dominer le vivant, dominer l’autre
Le roman semble ainsi se nourrir des alertes climatiques lancées par des pays subissant depuis de trop nombreuses années l’exploitation de leurs ressources. Les nomades du pays de Samaa souffrent de leur déclassement social, ils vivent en marge des villes dans la pénurie et l’inconfort quand les citadins ont encore accès à de l’eau et à des légumes. Ces nantis peuvent se permettre d’acheter les derniers spécimens de bois pour décorer leur intérieur. Tuer le vivant et le changer en matière inerte pour le plaisir des yeux, s’accaparer une ressource vitale pour en faire un objet décoratif, difficile de ne pas nous identifier à ces gens de la Ville qui vivent dans l’inconscience que leur consommation d’objets superflus opprime et asphyxie d’autres vivants.
Au début du roman, Samaa raille l’Ancienne dont les récits d’une nature généreuse et perdue bercent les soirées du camp. Elle désire elle aussi abattre des arbres pour occuper une position valorisée dans sa communauté, jusqu’au jour où tout change. Avec le temps de la puberté, temps du changement et du questionnement, elle est contrainte de se débarrasser de sa cécité ; tombée au fond d’une trouée dont elle ne ressortira qu’après une centaine de pages, Samaa est immobilisée par une cheville brisée. L’histoire refuse l’aventure. Pas de roman d’initiation traditionnel ici : l’héroïne ne multipliera pas les rencontres et les combats, elle se retrouvera à l’inverse dans la plus grande solitude jusqu’à se rendre compte que cette solitude n’en est pas une. De l’immobilisme du récit naîtra alors l’émerveillement. De belles pages empreintes de sensualité font basculer Samaa dans la connaissance du vivant. L’eau chante à travers ses doigts, le regard naïf transfigure ce qu’on croit si bien connaître pour le changer en spectacle inédit.
L’eau est translucide, le fond sableux, et de longs cheveux verts s’y dressent en ondulant vers la surface. Je tends la main. Le contact de l’eau est incroyable : frais, doux. Je souris pour de vrai. J’enfonce mon avant-bras et effleure les cheveux. Ils chatouillent, continuent leur langoureux mouvement, ralenti, hypnotique, comme les flammes lorsqu’on allume les pierres d’étincelle et que les langues de feu s’élancent vers le ciel. On dirait qu’elles veulent rejoindre quelqu’un d’invisible dans les étoiles. Les cheveux ne sont pas des animaux, on dirait des buissons d’eau. Je bouge ma main à droite, à gauche, l’eau résiste, me suit à contretemps, reflue. Je fais chanter l’eau.
Les mots de Marie Pavlenko ne se font pas savants et théoriques, ils cherchent à articuler notre lien à la terre de façon expérimentale, aboutissant indubitablement à un « Que pouvons-nous faire et comment ? »
En finir avec la société séparatiste
Au camp, les hommes et les femmes subissent la plus grande polarité possible. Aux hommes, la chasse, le désert infini, la violence, les bêtes sauvages, aux femmes, le tissage, le foyer, l’attente et le soin. Samaa fait figure de nouvelle Eve : elle réconcilie ces mondes qui se croisent sans partager. Elle contamine les savoirs et les groupes : se souvenant de l’enseignement des femmes, elle tisse plusieurs jours durant des cordes qui lui permettront de s’élever dans l’arbre à l’abri, en utilisant la technique de l’escalade au mât que son père lui avait transmise. Loin du regard de la communauté, elle s’autorise la transgression du genre qui lui a été assigné ; grâce à son ingéniosité, elle se fabrique un hamac et une couverture qui l’aideront à endurer les nuits froides. L’image du tissage n’est pas un détail ici. Souvenez -vous du livre que Mehdi déniche dans une brocante dans la BD Resisters : Reweaving the world (Retisser le monde) de Irene Diamond et Gloria Orenstein publié en 1990, le livre évoque le devoir de réparer ce qu’on a endommagé. Les liens perdus avec le passé, avec les savoirs dévalorisés, les récits oubliés, la voix des ancêtres malmené.es, se retissent lentement et péniblement mais ils se retissent comme on regarde des graines renaître en semis, en plantule puis en plante à condition qu’on lui ait donné toute l’attention et le soin nécessaires à son développement. C’est le tissage d’une attelle qui guérira la cheville de Samaa et lui permettra de se relever, même terriblement affaiblie par l’inanition. Quels sont ces savoirs qu’on moque dans notre civilisation et qui pourraient aider l’Humanité à se souvenir et à imaginer la suite ? On nous transmet le mépris, on nous apprend à rejeter des discours de sagesse, de cette Ancienne à la bouche édentée parce qu’ils sont des freins à une exploitation capitaliste du vivant, au nom d’une croyance productiviste.
– Ah mes chères petites, si vous aviez connu le monde d’avant…
Je cherche Tewida du regard mais la traîtresse m’évite. Toujours sage. Je soupire avec ostentation. L’Ancienne poursuit.
– Les arbres n’étaient pas cachés dans les trouées du désert. Ils n’étaient pas réduits au bohis, cette marchandise rare qui fait perdre la tête aux idiots de la grande ville. […] Savez-vous ce que c’est qu’une forêt ? Non, bien sûr comment le pourriez-vous ? Elles ont disparu depuis si longtemps. […]
Bla bla bla.
Je n’écoute pas. Elle ne me fera pas changer d’avis
Le monde patriarcal est violent envers la nature ; les hommes abattent les arbres, ils sont sourds à leur magnificence. Que les arbres retiennent l’eau dans leur réseau racinaire, qu’ils abritent une faune variée, qu’ils soient les hôtes des nidifications, une réserve de nourriture et de médecine, ils n’en ont cure ; l’appât du gain les obsède. Les deux mille femmes qui ont marché vers le Pentagone le 17 novembre 1980 pour manifester leur peur de voir le monde tel qu’elles le connaissaient disparaître nous ont alerté.es:
Nous nous rassemblons car nous avons peur pour nos vies. Peur pour la vie de cette planète, notre terre et pour la vie de nos enfants qui sont notre avenir humain. […] Nous sommes entre les mains d’hommes que le pouvoir et la richesse ont séparés non seulement de la réalité quotidienne mais aussi de l’imagination.
« Pouvoir » et « Richesse », les ennemis sont nommés. La course à l’armement, la déforestation massive, la surexploitation des ressources souterraines et fossiles, les famines à répétition partagent le même visage.
Une initiation écoféministe
Samaa suit son initiation au creux d’un tronc, tapie dans le coeur d’un feuillage et renoue avec une vision organiciste de la nature, d’avant la vision mécanique du XVIIe siècle. Dans les années 80, Carolyn Merchant écrit que, de l’Antiquité à la Renaissance, la terre a été vue comme un grand vivant, une entité nourricière qui portait la vie. A cette vision étaient associées des contraintes morales, garde-fous qui empêchaient les êtres humains de lui nuire : on ne poignarde pas sa mère, on ne lui perce pas les entrailles pour en extraire de l’or, on ne mutile pas son corps. Samaa s’excuse de devoir prélever un bout d’écorce ou d’entailler l’aubier pour faire couler la sève. Chaque geste aussi infime soit-il est médité, si bien que le bruit de la lame qui éclate le bois devient insupportable aux oreilles du lecteur. Elle comprend que l’exploitation du vivant n’est pas l’histoire de l’émancipation de tout le genre humain, que son peuple continuera d’être le perdant, mais que cette exploitation maintient l’assise des puissances dominantes, celles des bourgeois, des villes, des pays colonisateurs. Pendant ce temps, les femmes, la nature et les populations pauvres subissent tous les sévices, toutes les violations de leurs droits de vivant.es.
Le roman de Marie Pavlenko nous donne l’occasion (une de plus !) d’en finir avec une relation mortifère au vivant. Mettre les ressources en coupes réglées, les débiter, les démanteler, cette relation à la terre a fait long feu. Dans les dernières pages, Samaa revient au foyer, elle retrouve l’oïkos, la demeure de sa mère et de l’Ancienne. Son geste final signe sa naissance en écoféministe ; en libérant le contenu de sa main, trésor de son aventure enfin terminée, elle invite les autres à réaliser l’avenir de l’Humanité : faire de la Terre un jardin planétaire.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.