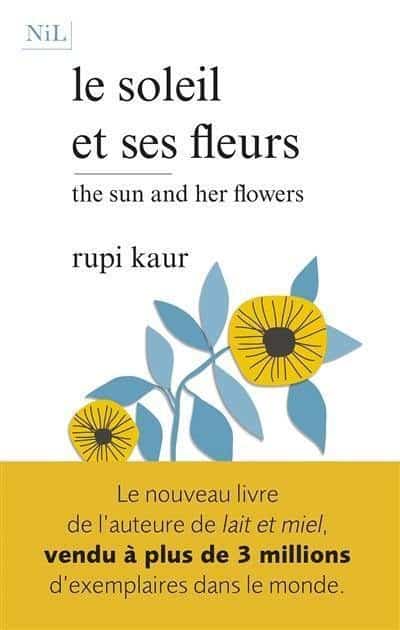Quand la maison d’édition toulousaine Blast a parcouru il y a quelques années les deux manuscrits qu’une jeune femme trans marseillaise lui avait envoyés, elle a été soufflée par la puissance évocatrice des mots de Luz Volckmann. Sans vraiment nous laisser le temps de reprendre notre souffle, Les Chants du placards et Aller la rivière sont parus en 2020 et en 2021, deux bouées poétiques jetées à la surface de l’eau que nous rejoignons avec plaisir comme une île bienvenue aux yeux du naufragé.
La prose inspirée des chants du placard raconte la mise sous silence des voix et des corps queer, de celles et ceux qui ne font pas partie du camp des vainqueurs et dont on essaie de réduire la présence au monde jusqu’à leur élimination dans des réduits, des caisses sourdes qui éteignent l’écho des voix, voire dans des boîtes bonnes à mettre en terre. Espace étriqué, corps illégal, voix faussée, le placard étouffe la poétesse qui fait partie d’un « peuple de géants ». En sortir conduit inexorablement vers un corps neuf et une voix poétique renouvelée et c’est le deuxième opus de Luz Volckmann qui donne naissance à son identité de poétesse queer comme elle le disait elle-même lors de notre rencontre à la librairie Zeugma fin août à Montreuil.
Avec Aller la rivière, Luz Volckmann prend la tête du cortège des humilié.es, dont la vie en suspens peut s’arrêter à un coin de rue, lors d’un contrôle de police qui use de sa violence légale, lors des coups, des injures qui à force d’entrer en vous vous brisent de l’intérieur. Si le titre du recueil emprunte ses mots au premier poème, c’est qu’il s’ouvre en forme de memento, un espace de commémoration pour les amis de la communauté qui, un été particulièrement meurtrier, a pleuré ses disparus. Il fallait bien se retrouver, célébrer, et se purifier dans l’onde pour sécher le sang des lèvres fendues et emporter le souvenir des matraques, de l’odeur de l’asphalte sous la joue pressée au sol, de l’enfermement et des médicaments qui apaisent les blessures. Un long poème-ressource comme dit Luz volckmann dans lequel elle revient s’immerger, « [s]e baigne parmi [ses] souvenirs, [ses] douleurs et [ses] couleurs » :
« Aller la rivière
Enfoncer la cuisse
Cacher les seins
Tremper la tête
Avaler la tasse
Couler la rivière »
Fille de la sensualité, la rivière panse et guérit le deuil, elle file entre les doigts et ne s’attarde pas en phrases longues ; l’eau saute et ricoche d’un vers à l’autre, empruntant à une tradition poétique virgilienne où les abeilles butinent un nectar vivifiant et le soleil difracte nos visages cuits de chaleur, et désaltérés par les « averses merveilleuses des îles de ton ailleurs ». La légèreté de certaines strophes dissimule cependant difficilement les orages qui grondent et menacent. Un courant plus lourd nous entraîne vers le fond de l’eau par une succession d’images tourbillonnante, vers la vase qui avale tout et nous destine à notre solitude ultime :
« Je sais
Que l’on finit vase
Endormie vase
Dans le lit confortable des fonds de Seine et du Rhône »
Les spectres des corps ensevelis dans l’eau, figures assassinées roulent sur les galets. Luz Volckmann semble dédier ce recueil à ces voix de noyé.es qui s’opposent à un « vous » qui ne leur a jamais fait de place. La poétesse interpelle celles et ceux qui ont accaparé la parole et ne la partagent pas :
« Ce qu’il y a dans vos mots
Ce qu’il y a dans vos yeux
Je ne sais pas
Puisque ni le regard ni la langue
N’ont été faits pour nous »
Caisse de résonance des luttes trans/queer, les textes de Luz Volckmann renouent avec la poésie politique qui refuse de courber le dos, de bredouiller des excuses, ou de se consumer de honte pour être ce qu’on est. Quitte à être le cancre, autant le faire savoir et emporter dans son sillage toutes celles et ceux qui ont à cœur de mettre à mort la peur qui ronge et qui tue. Elle élabore une poésie de la profondeur qui ne dissocie pas les mots des actes, fidèle à Audre Lorde dont elle cite la pensée inspirante : « Je parle ici de la poésie en tant que sublimation révélatrice de l’expérience, et non de ce jeu de mots stérile au nom duquel, trop souvent, les pères blancs ont galvaudé le mot poésie – pour dissimuler leur aspiration manifeste vers une imagination sans profondeur. »

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.