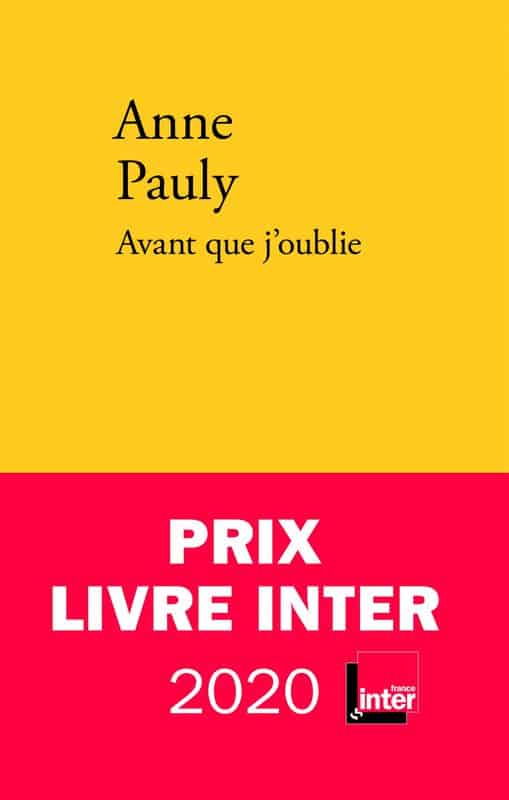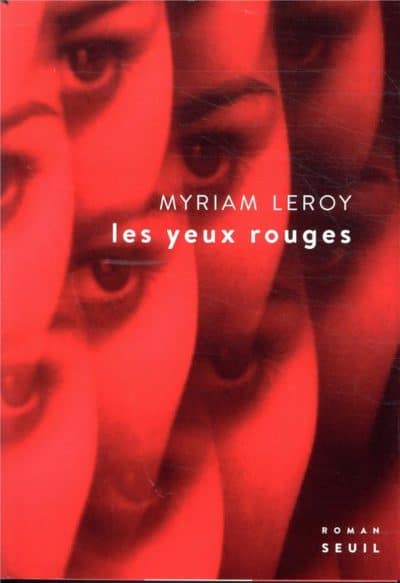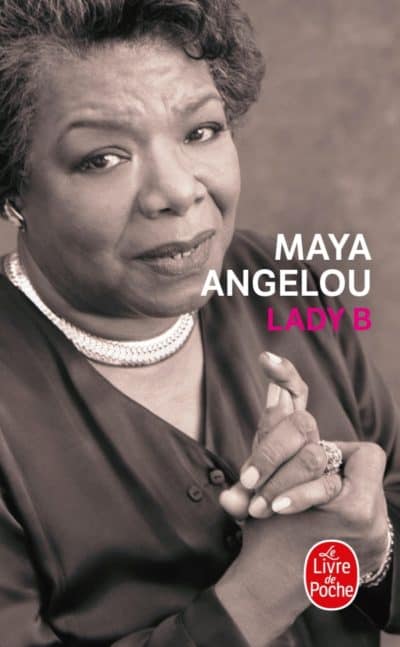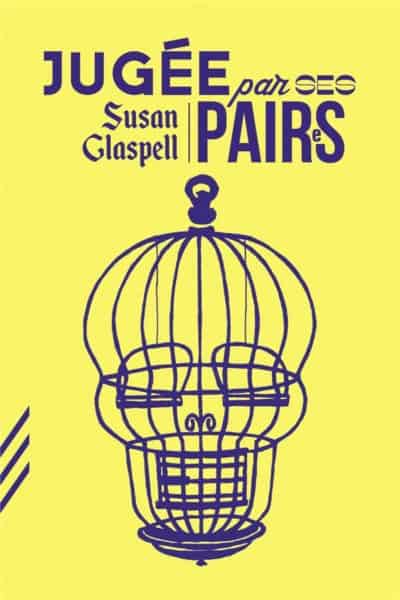Difficile de transformer les moments les plus tragiques de notre vie en scènes savoureusement burlesques, mais aussi de régler son compte à cette bonne vieille société inégalitaire et viriliste, productrice de vies au rabais. En prenant comme matière l’intime, Anne Pauly réussit ce pari avec talent puisque la critique lui a décerné le Prix du livre Inter 2020 pour son premier roman Avant que j’oublie.
On commence par la fin, la mort du père, monument anonyme tombé au sol dans le silence du monde. Ce moment de clôture d’une vie ouvre l’espace du roman, et le temps du deuil, ces quelques semaines hors du temps ordinaire pendant lesquelles les factures, les relevés de compte, les photos, les objets du défunt nous envahissent et avec eux les souvenirs attachés à cette existence qui survit à l’état morcelé avant la grande dispersion. Le temps de faire le tri. L’inventaire bordélique des placards de la chambre d’hôpital fait vibrer, quelques heures encore après, le lit vidé, silencieux. Traits d’union entre les enfants et le père, babioles, grigris, effets personnels, possessions orphelines devenues brutalement insignifiantes remplissent trivialement deux grands sacs Leclerc, comme si la mort avait grignoté pas à pas le corps, puis l’étendue de l’empire du père jusqu’à n’en laisser que des traces éparses. Pendant quelques jours, une immobilité inédite émerge : pendant que le corps flotte encore en surface, qu’il attend les derniers rites, les derniers hommages, avant qu’il ne rejoigne notre oubli, on se laisser envahir par les fragments qui remontent et on les assemble, comme les pierres mal jointes, parfois disgracieuses d’un édifice qui commençait à prendre l’eau. Construire le récit familial pour faire surgir les parts d’ombre sous la face sociale peu reluisante de celui qui fut le père revient à remplacer le mythe par la fable.
L’écriture d’Anne Pauly remodèle la statue du père Minotaure, ogre et colosse qui tyrannisait la famille et condamnait la mère et les enfants à errer dehors par les nuits où ses accès de violence se faisaient trop menaçants. L’alcool, l’écrasement de son épouse, l’alcool, la culpabilité de ne pas être à la hauteur de la virilité attendue, l’alcool. Elle l’augmente de nouvelles excroissances : le père cowboy, prêt à toutes les provocations pour faire exploser la comédie des apparences d’un monde trompé à ses propres illusions, quitte à se faire embarquer par les flics menottes aux poignets ; se cabrant régulièrement lors de scènes cocasses contre cette vie à Carrières-Sous-Poissy, celle du pavillon à la façade décrépite qui n’a pas tenu les promesses d’un bonheur matérialiste dans la France de Giscard :
« Bien sûr, c’était une autre époque : on recommandait à la population de consommer de la bière les jours de canicule, les gendarmes traquaient les nudistes à Saint-Tropez, Yves Montand roulait à tombeau ouvert, sans ceinture et de nuit pour rejoindre Romy Schneider, après s’être enfilé deux trois apéros, et une bonne baffe calmait les épouses récalcitrantes. Dans la France de Giscard, il fallait se comporter comme un homme et il avait joué, comme tant d’autres, la comédie de son temps. Mais il n’avait jamais voulu entendre qu’il avait exagéré avec tout ça »
L’autrice s’arrête longuement sur cette vie d’homme de classe moyenne qui aspirait aux voix d’ange – comme celle de la mère ou à celle des petits bouddhas, reliques d’une spiritualité endormie – et à qui on n’a donné qu’une existence morne, qu’on a méprisé sans lui laisser la place d’épanouir ses rêves et ses envies, condamné par son origine avant d’avoir vécu. Sans excuser la violence du père, qu’il a d’ailleurs donnée en partage à son fils Jean François, double paternel modernisé, Anne Pauly cherche à comprendre pourquoi elle continue d’aimer cet homme, à lui dédier ses journées, jusqu’à devenir la garde-malade qui essuie les seaux de pipi, le sang, la merde et les coups de colère de celui que la vieillesse et la maladie ont écorné. De colosse, il passe à l’enfant, au corps victimaire, souffrant, silhouette toujours plus maigre, en caleçon pitoyable, prisonnière dans son fauteuil roulant, amputée : à en crever de solitude. Même dans la chute, père et fille sont des partenaires dans le crime : épuisée par les caprices et les soirées silencieuses, elle fournit quand même à son « junkie » de père les substituts de l’alcool qui ne parvient plus à soulager ses souffrances et elle continue de poser sur lui un regard admiratif et fasciné, parce que son père est avant tout à ses yeux une icône punk qui dérange l’ordre bienpensant jusqu’au cœur de l’hôpital, autre scène du monde si réglé :
« Il est sorti de la chambre 302 tambour battant dans un cliquetis de béquilles. Je l’ai suivi tant bien que mal, la perf à roulettes dans une main et la bouteille d’oxygène dans l’autre. La vue de ce vieil échassier déplumé au ventre énorme, seulement vêtu d’une petite casaque de coton à imprimés bleus et d’un slip trop grand a effrayé une mamie en robe de chambre qui passait par là à pas de souris. Cette dégaine, cette absence de gêne physique dans la façon de se présenter au monde, c’était tout lui : il vandalisait par sa seule présence l’imaginaire des secrétaires et des comptables, leur renvoyait en pleine figure et en un instant, l’inanité de leurs efforts pour avoir l’air de quelqu’un dans le monde étroit qu’on leur proposait. »
Né à une autre époque, entouré différemment, ce père aurait pu épouser les revendications libertaires, fustiger la loi des cons.nes et faire jubiler dans son sillon une foule de personnes désireuses de voir la comédie du monde cesser son cirque. C’est sans doute cet héritage que réclame Anne Pauly avec beaucoup d’humour chaque fois qu’il est question des frasques du père ou de sa propre inadaptation au vieux monde des banlieues qu’elle a elle-même abandonné il y a bien longtemps pour vivre au cœur de la frénésie de la capitale. Agacée par sa propre réserve face à un prêtre qui déballe tous les clichés de l’homme de Dieu réac et hétérocentré, elle convoque en pensée la figure paternelle au secours de sa paralysie sociale, et de son incapacité à se révolter face à ces formes familières de l’oppression. Qu’aurait-il fait ce pied nickelé, ce Marlon Brando des supermarchés ? Son esprit de héros surgonflé continue de planer sur la famille quand elle descend l’allée qui mène à la chambre funéraire et pense :
« […] tous vêtus de noir, j’ai eu un bref instant l’impression qu’on allait braquer un casino. Au-dehors, avec mon père et mon frère, avant que ma mère ne me kidnappe pour faire de moi une fille, j’avais toujours eu cette sensation presque physique, d’appartenir à une horde puissante et respectée au-delà des frontières du royaume, à une meute d’individus farouches aux corps de Huns, brutaux mais justes, réunis par le hasard et la nécessité pour faire face aux coups fourrés du destin »
Débarrassé du masque déformant de son addiction à l’alcool, et du masque de la comédie sociale qui voilait sa générosité et ses fragilités d’homme, le père apparaît moins monstrueux, plus attendrissant dans sa vulnérabilité, brutal, maladroit certes, mais aussi aimant et généreux. En époussetant les bibelots, en rendant leur éclat premier aux souvenirs, l’image du défunt apparaît plus humaine, moins fantasmée.
Quand l’homélie du prêtre sonne faux, quand les fous rires percent la solennité et les mensonges, quand les pleurs sont versés, quand on essuie les verres et qu’on range la vaisselle à sa place dans le placard de la cuisine après avoir emballé les restes du repas, la messe est dite. Certes, mais une messe ne suffit pas à faire taire la douleur de la perte. Dans son obscénité, le monde ne fait pas taire le chant des oiseaux, le chien ne cesse pas d’aboyer, les voitures continuent de rouler et les infirmières de vaquer aux soins. Alors pour tarir les larmes, il ne reste plus qu’à conjurer la tragédie de l’indifférence avec le rire et à rendre hommage à ce père, éclatant d’humanité grâce à sa fille. Sa vie n’aura été ni vaine ni anonyme puisque la revanche est là. Le livre est publié, le père vengé et les coupables épinglés.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.