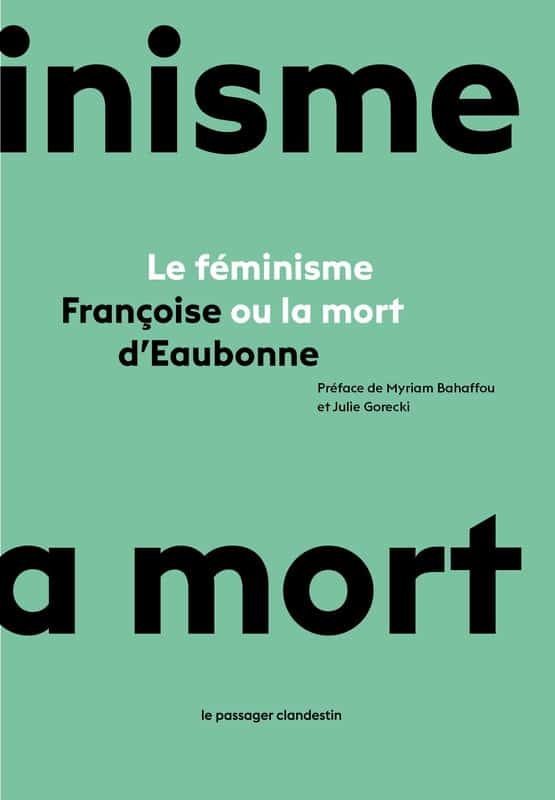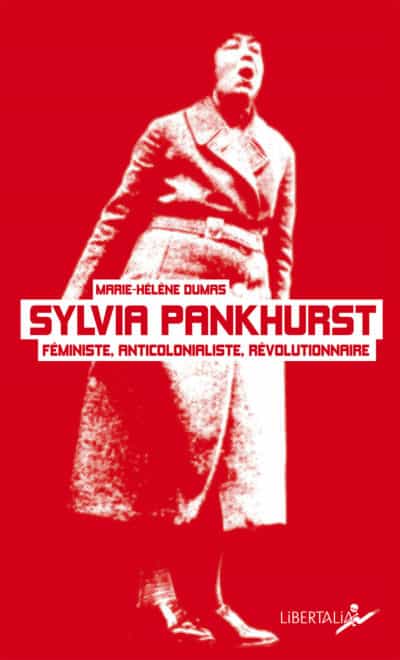En 1974, Françoise d’Eaubonne, co-fondatrice du MLF où elle anime le groupe « Écologie et Féminisme » et du FHAR (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire) publie son essai Le Féminisme ou la mort où elle pose les bases d’un écoféminisme à la française parallèlement au mouvement qui se développe aux États-Unis. Difficilement trouvable depuis, il est enfin réédité par Le Passager clandestin en 2020, enrichi d’une préface passionnante écrite à quatre mains par les universitaires et militantes Myriam Bahaffou et Julie Gorecki.
L’écoféminisme, c’est le courant de pensée qui postule que les mécanismes de domination des femmes par les hommes sont similaires à ceux de la domination des hommes sur la Nature. Revenu sur le devant de la scène depuis quelques années, notamment via Starhawk ou Émilie Hache, l’écoféminisme devrait sembler comme allant de soi alors que nous sommes au cœur d’une pandémie mondiale et d’une crise climatique inédite. Pourtant, à la lecture du Féminisme et la mort, on se dit que les choses n’ont pas vraiment évolué, en tout cas pas dans le bon sens. À l’époque de l’écriture déjà, Françoise d’Eaubonne s’inquiète de la surpopulation et de la surconsommation qu’elle entraîne. Pour elle, il est déjà trop tard pour protéger le monde. Elle propose alors de se ranger derrière Valerie Solanas et d’organiser la destruction totale du pouvoir par les femmes pour le réinventer, ce monde. Cinquante ans plus tard, la grève des ventres n’a pas pris, l’ultra-libéralisme triomphant piétine allègrement tout ce qui croise son chemin, et les femmes qui ne souhaitent pas d’enfants, que ce soit pour raisons politiques ou intimes, sont toujours considérées avec une certaine méfiance alors qu’elles sont de plus en plus nombreuses.
Ainsi donc nous dit Françoise d’Eaubonne, le contrôle du ventre des femmes via l’interdiction (à l’époque) de l’avortement et la lenteur de l’invention d’un contraceptif (elle situe en 1856 la découverte d’un moyen d’empêcher l’ovulation, presque cent ans avant que les recherches sur la pilule démarrent) entraîne une sorte de folie reproductrice des hommes qui veulent laisser une trace de leur passage (ceci, nous dit-elle également, en laissant totalement l’enfant à la mère une fois né), et qui elle-même entraîne surconsommation et destruction de l’environnement.
Cependant le texte comporte deux problèmes très justement pointés dans la préface. Le premier, c’est sa façon d’essentialiser les rapports. En utilisant le terme « phallocratie » plutôt que « patriarcat », Françoise d’Eaubonne met l’accent sur les organes génitaux et escamote totalement le genre comme construction sociale au profit du seul sexe biologique, ce qui exclut de facto les personnes transgenres. Le deuxième, c’est le tour de magie qui fait passer la colonisation pour un détail historique et pas pour le processus de domination de l’homme blanc sur le reste du monde qu’elle est. L’autrice fait notamment preuve d’un certain misérabilisme lorsqu’elle évoque les femmes africaines en s’exprimant du haut de ce qui est identifié aujourd’hui comme le privilège blanc. C’est ici que Myriam Bahaffou et Julie Gorecki font un travail formidable. Tout en relevant le racisme et la transphobie qui émaillent le livre, les deux chercheuses les replacent dans le contexte des années 1970 et proposent non pas d’effacer la pensée de Françoise d’Eaubonne mais de s’y appuyer pour aller plus loin encore. On ne peut que conseiller, pour une fois, de ne pas faire l’impasse sur la lecture de la préface mais de s’en imprégner afin de comprendre comment articuler l’écoféminisme avec les autres luttes sans le considérer comme un délire mystique vendu par les start-uppers du bien-être.

Audrey se découvre féministe après un atelier d’écriture de Chloé Delaume. Depuis, elle avale autant de livres écrits par des femmes que possible. Son objectif de vie : avoir plus d’autrices que d’auteurs dans sa bibliothèque.