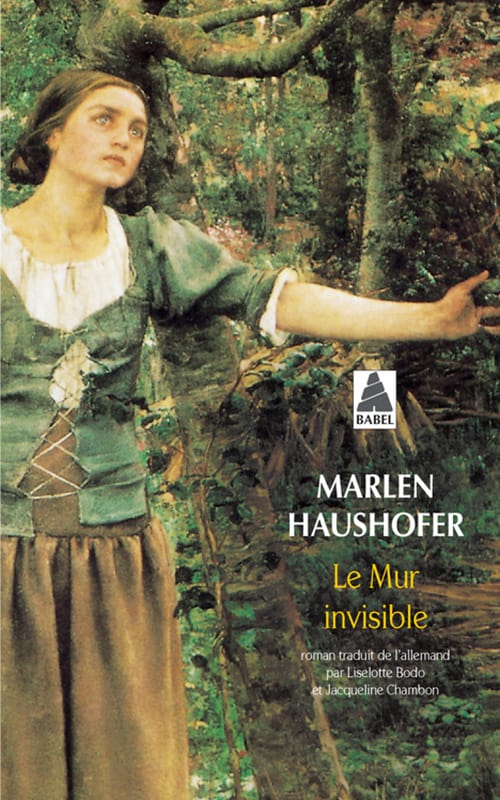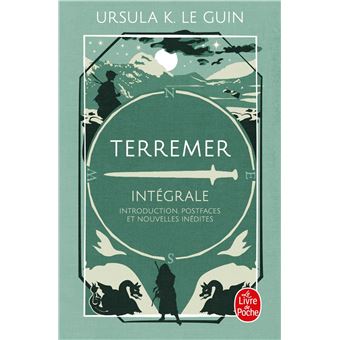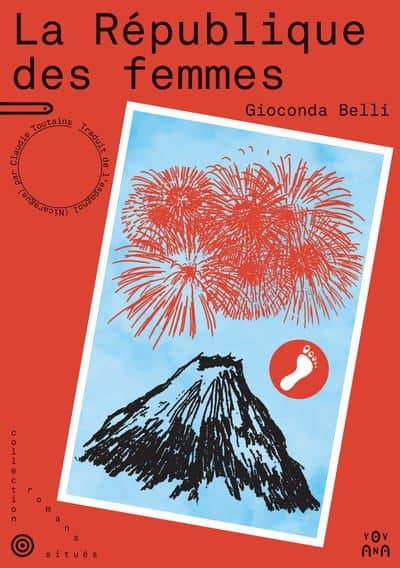Dans ce roman publié en 1963, l’autrice autrichienne Marlen Haushofer revisite avec poésie la figure de l’ermite. Elle y décrit la survie, raconte la solitude, célèbre la beauté de la nature et dénonce la société patriarco-capitaliste. Un beau texte écoféministe.
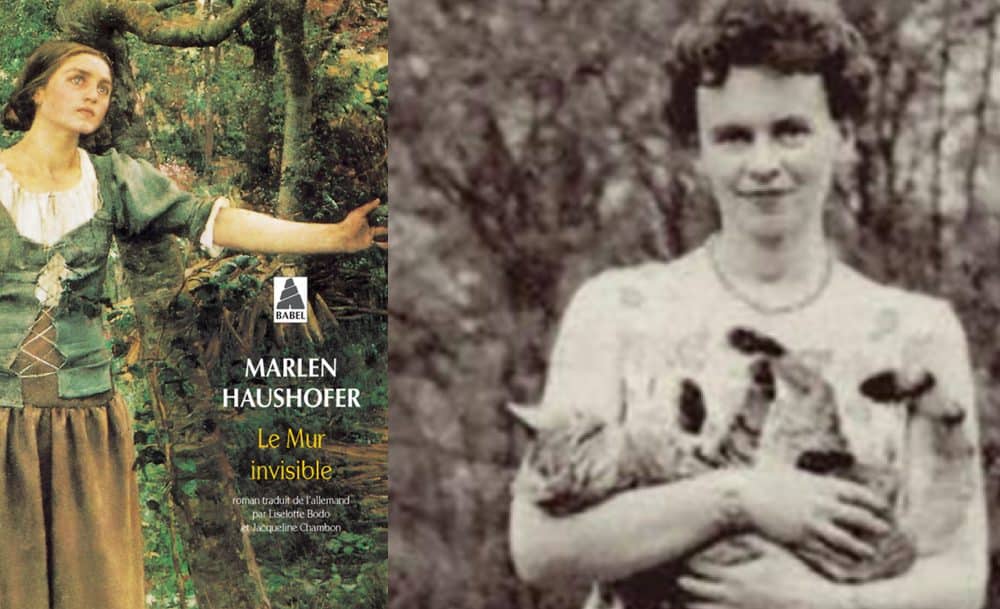
Au lendemain d’une catastrophe planétaire, une femme se retrouve seule dans un chalet en pleine forêt autrichienne, séparée du reste du monde par un « mur invisible » au-delà duquel plus aucune vie ne semble exister. L’héroïne, dont on ne connaît pas le prénom, se retrouve seule au milieu de la campagne en compagnie de Lynx, le chien des amis chez qui elle se trouvait alors, une chatte et une vache, qu’elle surnomme Bella.
Dans Le Mur invisible, publié en 1963 dans un contexte de post-guerre froide, l’autrice autrichienne Marlen Haushofer écrit le journal de bord d’une femme de 40 ans à la vie tout à fait ordinaire jetée dans la plus exceptionnelle des situations. Le texte relate, jour après jour, ses deux premières années d’ermitage forcé.
Si l’œuvre aurait pu être un simple exercice de survivalisme, il n’en est rien. Ce journal intime tantôt contemplatif tantôt descriptif est d’une immense beauté. On y trouve ces longs silences amis de la solitude, des angoisses étouffées mais surtout de profondes réflexions sur notre rapport à la nature, aux animaux et à la société des hommes qui, tout au long du texte ne semble plus être qu’un lointain souvenir d’une évidente vacuité. C’est enfin, et surtout, l’histoire d’une femme qui, délivrée des attentes de la société patriarcale et du regard des hommes, retrouve soudainement sa liberté.
Survie et solitude
Il ne semble plus y avoir d’hommes sur terre. De l’autre côté du mur, les quelques personnes qu’elle aperçoit sont figées, comme des poupées de cire. Malgré cette situation angoissante, la narratrice ne cède jamais (ou presque) à la panique. Au contraire, d’un ton humble et avec une dignité émouvante, elle organise rapidement sa survie. « Je dois seulement veiller à rester en bonne santé et être capable de m’adapter », écrit-elle. Brutalement ramenée à ses besoins les plus fondamentaux, la femme âgée d’une quarantaine d’années est contrainte à un rude investissement physique. Elle s’en veut de ne pas connaître le nom des plantes qui l’entourent, de ne pas maîtriser le système de reproduction de ses bêtes ou encore de ne pas être capable de construire une porte pour l’étable : « J’ai souffert pendant deux ans d’être cette femme, si mal armée pour affronter les réalités de la vie ». Pourtant, au fil des jours le personnage de Marlen Haushofer se montre de plus en plus habile au travail de la terre et à l’entretien des bêtes. Désormais, ses doigts sont comme « des outils » et elle réalise que le corps qu’elle habite est d’une puissance insoupçonnée.
Au bout de quelques semaines seulement, l’héroïne s’est organisée. Le matin elle nourrit et change la litière de ses bêtes, elle traie Bella la vache pour boire son lait, s’occupe de ses plantations de pommes de terre et de haricots et coupe du bois pour pouvoir se chauffer. Dans l’un des plus beaux passages du roman, elle se demande alors si elle aurait aimé que le garde-chasse qui travaillait dans la vallée soit resté avec elle de ce côté du mur : « Dieu sait ce que l’emprisonnement dans la forêt aurait produit chez cet homme. En tout cas, il était physiquement plus fort que moi, et je serais tombée sous sa dépendance. Qui sait, il se serait peut-être aujourd’hui paresseusement allongé dans la cabane après m’avoir envoyée travailler. La possibilité de se décharger du travail doit être la grande tentation de tous les hommes. […] Non il vaut mieux être seule ». […] Elle ajoute également qui si elle avait eu un partenaire plus faible, elle aurait pris tellement « grand soin de lui qu’il en mourrait », affirmant que la seule présence qu’elle aurait toléré est celle d’une « femme âgée, intelligente et spirituelle ».
Libérée des stéréotypes de genre
Seule au milieu de la forêt, l’héroïne évolue sous le seul regard de la nature et des animaux. Il n’y a plus de regards humains pour la contraindre, lui permettant progressivement de se libérer des normes liées à son genre. « Si étonnant que cela puisse paraître, j’avais l’air plus jeune que lorsque je menais une vie confortable. La féminité de la quarantaine s’était détachée de moi en même temps que mes boucles, mon double menton et mes hanches arrondies. Par la même occasion j’ai perdu la conscience d’être une femme. […] J’avais acquis le droit d’oublier ma condition. Parfois j’étais une enfant qui cherchait des fraises, puis un jeune homme qui sciait du bois, enfin, assise sur le banc, Perle sur mes genoux en train de contempler le soleil, je devenais quelqu’un de très âgé, sans sexe défini ». Son corps n’est plus prisonnier des dictats de la beauté. Il est devenu son allié, un outil formidable lui permettant d’assurer sa survie.
Cependant, il est dur de se défaire complètement du regard et des attentes de la société patriarcale et, l’autrice, à travers les mots de sa narratrice, évoque régulièrement le souci de la charge mentale et émotionnelle qui incombe aux femmes. Celui d’être « des mères » au sens large du terme : se soucier du bien-être des autres parfois au détriment du leur, s’assurer en permanence que tout va bien et que tout le monde est heureux. En effet, cette dernière s’inquiète perpétuellement du bien-être de ses bêtes : vont-ils se faire mal ? Ont-ils assez chaud et assez mangé ? De quoi sera fait leur avenir ? À chaque naissance d’un nouveau chaton, elle craint déjà de le perdre et se promet de veiller sur lui quoi qu’il arrive : « Autrefois, bien avant que qu’il soit question du mur, j’ai parfois souhaité être morte pour enfin être libérée du poids qui pèse sur moi. Je n’ai jamais osé parler à quiconque de ce lourd fardeau, un homme ne m’aurait pas comprise, quant aux femmes elles ressentaient la même chose. C’est pourquoi nous préférions nous entretenir de robes, d’amies ou de théâtre et rire ensemble, sans jamais perdre de vue ce souci qui nous dévorait en secret. Chacune de nous le connaissait et c’est la raison pour laquelle nous n’en parlions pas. Car tel est en effet le prix qu’on doit payer pour être capable d’aimer ».
Une ode à la nature
L’héroïne comprend au fil des jours à quel point sa survie est assujettie à la nature, au rythme des saisons et à l’exploitation durable et raisonnée de ses ressources environnementales. Elle se déplace dans la vallée en fonction des saisons, calque ses journées au rythme de celui de ses animaux et du soleil. Si les débuts sont difficiles, la citadine renoue très vite avec ses racines paysannes : « A cette époque, je ne savais pas encore reconnaître les différents signes qui me permettent à présent de prévoir le temps ». Puis à force de pratique et de répétition, elle se laisse apprivoiser par la nature et se plie avec bonheur à ses règles jusqu’à avoir le sentiment grisant de faire humblement partie de ce tout. « Ce n’est pas que je sois laide, plutôt ingrate, je ressemble davantage à un arbre qu’à un être humain, une souche brune et coriace qui a besoin de toute sa force pour survivre », écrit-elle. Ou encore plus loin : « Quand mes pensées s’embrouillent, c’est comme si la forêt avait commencé à allonger en moi ses racines pour penser avec mon cerveau ses vieilles et éternelles pensées ».
Le regard qu’elle porte sur la nature et sur les animaux est d’une bienveillance et d’une poésie émouvantes. À force d’observer non seulement le fonctionnement de ses bêtes mais également leur caractère, leur façon de se mouvoir, de ressentir les choses, la narratrice développe une grande admiration et un respect presque mystique envers ces dernières : « Ce n’est pas que je redoute de devenir un animal, cela ne serait pas si terrible, ce qui est terrible c’est qu’un homme ne peut jamais devenir un animal, il passe à côté de l’animalité pour sombrer dans l’abîme ». Elle va même jusqu’à assumer avec courage et lucidité son goût pour la solitude voire une certaine misanthropie : « Je plains les animaux et les hommes parce qu’ils sont jetés dans la vie sans l’avoir voulu. Mais ce sont les hommes qui sont sans doute le plus à plaindre, parce qu’ils possèdent juste assez de raison pour lutter contre le cours naturel des choses. Cela les a rendus méchants, désespérés et bien peu dignes d’être aimés. Et pourtant il leur aurait été possible de vivre autrement. »
Un texte écoféministe
Vivre autrement. Car ce texte est aussi une vraie réflexion, en creux, sur le fonctionnement de nos sociétés capitalistes et le rapport qu’elles entretiennent avec la nature et nos ressources naturelles : « Ici, dans la forêt, je me trouve enfin à la place qui me convient. Je n’en veux plus aux fabricants d’autos, ils ont depuis longtemps perdu tout intérêt. Mais comme ils m’ont torturée avec des choses qui me répugnaient ! Je n’avais que cette petite vie et ils ne m’ont pas laissé vivre en paix ».
Une expérience qui l’amène également à remettre en question le mode de vie lié à la consommation : « Pendant le long chemin du retour, je repensai à ma vie passée qui m’apparut insuffisante à tous points de vue. J’avais réalisé bien peu de ce que j’avais voulu, et quand j’étais parvenue à réaliser quelque chose, j’en voulais déjà plus ». Au fil des pages, l’héroïne prend conscience avec poésie de son rapport au temps. Anciennement dicté par le consumérisme, le productivisme et des occupations qui lui semblent aujourd’hui vides de sens, sa temporalité est celle de la nature. Et c’est pour elle une grande source de liberté et de bonheur.

Journaliste, Margaux rentre tout juste du Maroc où elle a travaillé pendant trois ans. Spécialisée dans les questions de société, elle a couvert de nombreux sujets liés aux inégalités hommes-femmes. Éternelle lectrice, elle souhaite aujourd’hui partager ses découvertes et, qui sait, éveiller de futures consciences féministes.