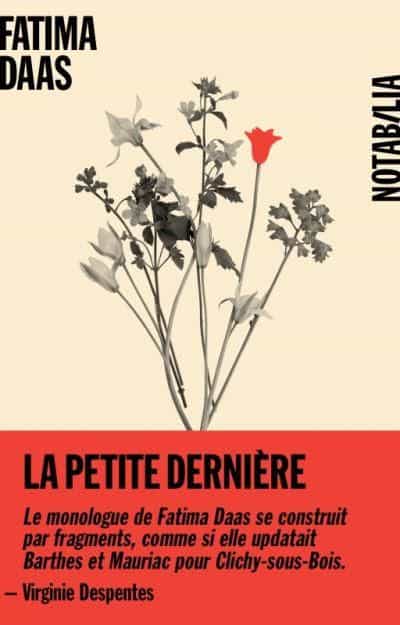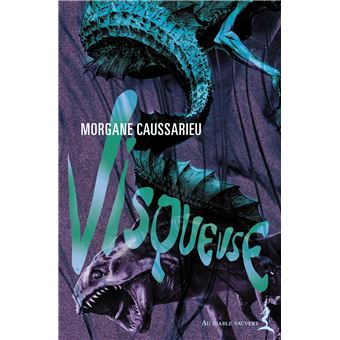1868 : grève des ovalistes à Lyon. Ces ouvrières des moulinages de soie prennent la colère et se mettent en grève pour de meilleures conditions de travail. Assez de gagner moins que les hommes, de s’entasser dans des dortoirs insalubres à partager sa couche et les maladies qui se propagent dans la promiscuité misérable à laquelle sont condamnées ces jeunes femmes. Employées à tordre le fil de soie avant de l’enrouler sur des bobines jusqu’à 12 heures par jour, elles s’épuisent dans des usines-pensionnats où leur liberté est sous surveillance. Pendant un mois, cette première grève de femmes connue à ce jour fait éclater les cœurs et les jettent en bandes de filles bras dessus bras dessous dans les rues jour et nuit, émancipées des chefs d’atelier et de leurs compagnons, allant de place en place se débaucher comme un torrent gonflé sous la colère en crue.
Avec notre quatuor nous infiltrons l’orchestre. Nous ne connaissons pas la musique. Avec nos quatre relayeuses, nous chantons les yeux fermés. Elles nous conduisent vers la foule des femmes en grève, la foule des ovalistes, dans les deux mille, deux mille femmes au moins, deux mille ovalistes, deux mille femmes ovalistes, et pas pour s’y diluer, se fondre dans la foule comme on dit, jamais peut-être elles n’auront été autant elles-mêmes que ces jours et ces nuits-là, des mois de juin et juillet 1869, si être soi-même consiste à se mêler, à parler fort, à être d’accord, à ne pas être d’accord, à rire, consiste à marcher sans se presser dans la rue, au milieu des autres, à marcher dans la rue de nuit, à envahir les cafés, pas en famille, pas discrètement en tête-à-tête, à sortir des ateliers, des dortoirs, de soi, être soi-même en sortant de soi, consiste à éprouver ce que nous ignorons, une ferveur ? une joie ? la joie et la peur de trahir les parents, les patrons ? un déchirement ? une rage ? Un allant ? consiste à reconnaître pareils sentiments, à se reconnaître.
Illettrées et traitées comme telles par leur supérieurs méprisants, elles n’auront pas gain de cause mais auront rendu possible l’autodétermination, le droit de débuter une grève sans attendre le feu vert des ateliers masculins, auront planté le germe de la revendication toujours actuelle de l’égalité salariale.

Derrière la métaphore de la course de relais qui traverse le roman comme un fil rouge, on voit poindre la solidarité d’un collectif balbutiant de femmes, l’entraide jusque dans l’épreuve de l’emprisonnement, de la répression et de la mort, un quatre fois cent mètres athlétique entre quatre ovalistes, quatre relayeuses, auxquelles l’image de femmes dociles et simplettes ne va plus. Maryline Desbiolles offre quatre visages à une foule anonyme dont on sait peu de choses sauf qu’elles n’ont pas usé de violences mais se sont contentées de réclamer la fin de la misère. Disons-le, elles se sont contentées de réclamer, point, et c’était déjà trop. Relever la tête n’était pas prévu ; tout fonctionnait pourtant pour que le dos reste courbé et honteux d’être des femmes sans qualités, dans un emploi non qualifié :
Elle a son livret que lui a fait ouvrir le patron, un livret de caisse d’épargne et de prévoyance, dont le siège est à la Croix-Rousse, tout près de l’atelier. Son livret d’ordre et de docilité. Il sait, le patron, que faire des économies maintient l’ordre et rend docile. Rosalie veut bien, elle veut de tout son cœur avoir une bonne conduite, être gentille et faire des économies, comme l’y enjoint le maitre moulinier Détric, comme l’y enjoint toutes les filles, toutes les femmes de l’atelier. Il dit qu’elles sont de bonnes filles. Et ce sont des paroles qui font baisser la tête.
A la fin, leurs revendications s’abimeront dans les paroles des autres, de l’écrivain public qui trahit leurs mots et des ouvriers qui parlent plus fort qu’elles. Elles ne verseront pas leur sang, parce que le leur ne cesse de couler :
Un sang impur n’abreuvera pas les sillons. Le sang, prétendument impur n’est pas celui des soldats ennemis, mais celui des ovalistes, sang impur, sang caché, de leurs règles, déflorations, accouchements, accidents domestiques sans gloire. L’étendard sanglant ne sera pas levé.
La révolte est choeur, pacifique, en équipée.
Le livre comme un écho lointain
A l’occasion de l’exposition Made in France, une histoire du textile qui prend ses quartiers jusqu’au 27 janvier 2025 rue des Francs Bourgeois aux Archives nationales, j’ai rouvert le livre de Maryline Desbiolles Il n’y aura pas de sang versé (Sabine Wespieser éditeur, 2023) pour calmer l’irritation qui montait dans ma gorge après avoir déambulé dans des salles qui chantaient les prouesses techniques de l’industrie textile, l’essor économique de la filière, et les politiques de contrôle d’État de Jean-Baptiste Colbert au 17e siècle jusqu’aux plans de sauvetage de la Ve République d’un fleuron qu’on détricote fil à fil. J’ai besoin de relire Il n’y aura pas de sang versé car je ne trouve pas dans l’exposition ce que je suis venue chercher : une histoire moderne, actualisée, plus complète qu’avant.
Il est vrai que l’exposition passionne par ses vitrines qui offrent aux regards des documents inédits sur le sujet. La France du 18e siècle cherche à égaler la grande maîtrise de ses concurrents sur le marché textile européen, elle est prête à débaucher des calandeurs jusqu’en Angleterre pour s’approprier les secrets de fabrication de la soie moirée qui fait fureur dès 1750 ; en atteste cet échantillon de soie, certifié par des négociants de Lyon qui garantissent la qualité équivalente de la soie exposée à la soie anglaise en 1756. Dans des albums bourrés de fibres diverses, John Holker, futur inspecteur général des manufactures étrangères, va savamment répertorier les bouts de tissu et leurs descriptions techniques au profit de la couronne française ; digne d’un roman d’espionnage, il va soustraire des outils, convaincre des ouvriers anglais de l’accompagner en France, et collecter les fibres à l’origine de la toile de jean qui deviendra iconique quelque temps plus tard. Mais cette course à la modernisation n’est pas qu’une histoire d’hommes : à côté des noms trop connus pour être présentés comme Vaucanson qui imagina des modèles de métiers à tisser en parallèle des automates qui lui assurèrent la gloire, on trouve celui de Marie Gagnière, inventrice et entrepreneuse qui inventa une soie factice conçue à partir de rebuts de coton dès 1778. Pionnière de l’upcycling, elle invente tout simplement un matériau alternatif moins cher que la soie et plus chatoyant que le coton, déclinable aussi bien pour l’habillement que pour l’ameublement. Hourra Marie Gagnière, trois petits tours et puis les femmes s’en vont.
A la gloire des grands hommes
Fin 18e et sous le Premier Empire, une dynamique d’État va pousser les manufactures à la mécanisation du travail pour augmenter les rythmes de production : c’est l’arrivée du métier Jacquard, qui représente un tournant pour les ouvriers et les ouvrières. On distribue des brevets d’invention aux ingénieurs et on multiplie les expositions et les récompenses pour stimuler l’esprit de création. Il fallait bien réagir au péril dans lequel se trouve le marché français dès 1786 avec la signature d’un traité de libre-échange avec l’Angleterre qui inonde les places commerçantes de textiles britanniques de bonne qualité et à bas prix. Le libéralisme et son illusoire auto-régulation, mis en place sous la Révolution Française, a bien failli être fatal au secteur textile : la production de soie s’effondre. Napoléon prend deux grandes mesures suite à sa visite de la Fabrique Lyonnaise en 1802 : il commandera 80 kilomètres de soie pour remeubler les palais impériaux, dont Versailles et il rétablira les chambres de commerce et les mesures protectionnistes douanières pour soutenir la production nationale. Ces décisions sauvent littéralement les lyonnais, éperdus de reconnaissance envers leur empereur.
Soit merci patron, merci Napoléon, mais c’est tout ?
Après avoir parcouru l’exposition, je cherchais partout la salle sur les archives des grèves du 19e siècle et du 20e siècle du secteur textile. Je revenais sur mes pas à la recherche d’une alcôve, d’une niche, d’un cabinet dérobé. Rien sur les grands mouvements ouvriers des années 1860-1870, ceux que Maryline Desbiolles prend pour cadre dans son roman. Ah si, là, une petite salle documente l’agonie du secteur dans les années 80 et la timide volonté d’État de maintenir son industrie avant de la livrer en pâture aux racleurs de carcasses du privé et aux spécialistes de la délocalisation des sites de production vers l’étranger. Toutes ces histoires de tissus anoblis parce qu’on parle de Colbert, de Louis XIV, de Napoléon, des révolutionnaires, de patrons multi-propriétaires commencent à faire bouillonner mon sang.
Puisque vous insistez
Faire l’histoire de l’industrie textile sans faire celle de sa population ouvrière ne rime à rien. En 1903, la Bourgogne-Franche-Comté n’emploie pas moins de 403 500 ouvriers.ères. C’est autour de Lyon un bassin d’emploi assuré pour les femmes et les hommes qui sont en quête de travail. Dans son livre, Maryline Desbiolles rappelle que bien souvent des colporteurs passent de village en village chargés de draps dans des baluchons et font étape pour recruter des ouvrières jeunes, prises dès les premiers signes de la puberté. C’est le cas de Toia, à peine réglée, et déjà objet d’une transaction entre sa famille et le colporteur sous la bénédiction du curé :
[…] ils sont venus les trouver, les parents, les frères, le dernier tout morveux et marchant à peine, et elle, la soeur aînée, la grande, elle ne savait pas encore à quel point, elle ne savait pas encore que dans quelques heures elle serait une femme, prétendument, elle, Toia, rougissante comme si on venait la demander en mariage, mais il n’était pas question de fiançailles, même s’il s’agissait bien d’elle, d’un marché la concernant. […] et lui, monsieur le curé, avait pensé à leur famille pour leur bonne réputation, leur bonne moralité, et à la petite Toia qui pouvait en France se constituer une dot, et revenir se marier à la Morra dans quelques années, trois ans tout au plus, il serait heureux de célébrer les noces, en France on gagne mieux, deux fois plus qu’ici, ce qui somme toute ne représentait pas grande chose, une misère multipliée par deux, et, s’empressa d’ajouter le colporteur les frais du voyage seraient payés par l’atelier de Lyon, ce qui impressionna la petite assemblée, le petit colporteur en profita pour sortir de ses poches des rubans colorés qu’il avait apportés pour les offrir à Toia et à sa mère, prémices des largesses qui seraient accordés à la jeune fille, Toia serait logée, nourrie à l’atelier, avec d’autres bonnes filles comme elle, des ovalistes on les appelle, et il fallut qu’il répète ce mot français inconnu d’eux […]
Dans Il n’y aura pas de sang versé, elles sont trois à converger vers Lyon : Toia la Piémontaise qui ne sait ni lire ni écrire le français, Rosalie Plantavin qui monte de la Drôme, Marie Maurier, originaire de Haute-Savoie ; seule Clémence Blanc est de Lyon même.
Pour ces travailleuses textiles, les années passées à l’atelier peuvent leur coûter la vie. Quand elles ne contractent pas des infections diverses et variées, celles qui manipulent les colorants de synthèse pour teinter la soie en vert peuvent s’intoxiquer à l’arsenic, comme s’empoisonnent aussi les acheteuses qui portent ces robes fatales.
Je passe ma route, pas d’ovalistes ici, mais quelques pas plus loin, Maryline Monroe, habillée d’un sac à patates !

Dans les années 50, une journaliste invective Marilyn Monroe lui reprochant ses tenues affolantes et lui conseille de s’habiller de sacs à tubercules. La vedette des fifties saisit l’occasion trop belle d’une réplique sexy à l’agresseuse : elle revêt un sac de pommes de terre et pose pour une série de clichés en forme de pied de nez. Sait-elle que l’expression « habillée comme un sac à patates » vient de la Grande Dépression qui frappe durement la population rurale des Etats-Unis en 1929 ? les familles manquent de tout et improvisent par nécessité des vêtements dans ce qu’elles ont sous la main… des sacs à pommes de terre. Les fabricants de sacs y voient l’occasion de se démarquer et ajoutent des motifs et des imprimés variés sur les toiles de jute. Marilyn pensait-elle : peu importe la toile quand on a le pouvoir de la mise en scène, le pouvoir de raconter l’histoire qu’on veut ?
Faut-il d’un côté réserver aux classes dominantes la soie et l’honneur d’inscrire des noms glorieux dans de jolies expositions parisiennes et de l’ autre renvoyer le peuple à ses pommes de terre et à la toile de jute qui sert à les empaqueter dans l’indifférence et l’anonymat ?
Draperie, soierie, rayonne, cotonnade, jersey, viscose ou lin. L’histoire des tissus comme celle des hommes et des femmes ne peut être confisquée par les commissaires d’exposition peu soucieux.euses de la représentation de tous et toutes : le sac à patates n’est associé à la vulgarité que par le regard qu’on porte sur le corps qu’on juge, la noblesse n’est pas dans l’étoffe mais dans le discours qu’on tisse. On aurait apprécié que les Archives nationales se souvienne de la leçon de Mme Monroe et sublime davantage la place du peuple et des classes laborieuses dans ce qui fut longtemps une gloire française. L’industrie textile doit retrouver la mémoire des femmes qui usèrent leurs doigts et leur dos au moulinage, et leurs pieds sur les pavés de la grève. Qui peut se charger de déposer un exemplaire de Il n’y aura pas de sang versé de Maryline Desbioles rue des Francs Bourgeois ? Je crois qu’il faut qu’on leur répète ce mot « ovalistes » inconnu d’eux.

Elle rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.