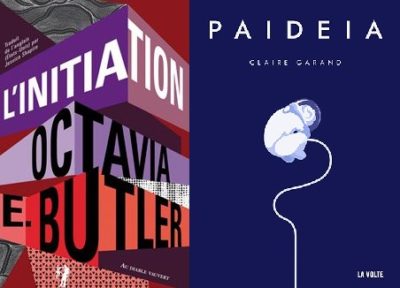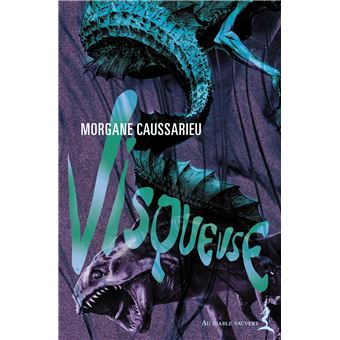En ces temps de fêtes et de retrouvailles, une chronique à contre-courant dédiée à toutes celles qui, faute de trouver la fin du patriarcat soigneusement dans le calendrier de l’Avent ce matin (et faut pas compter sur Papa Noël non plus pour ce sujet-là), se sont exclamé : putain, mais on pourrait pas juste dégager les mecs et vivre entre meufs pour toujours ?
J’ai déjà évoqué, dans une précédente chronique , des bouquins qui entrouvrent la parenthèse d’un monde où le mâle est une espèce éteinte. Ici, le scénario s’appuie sur un postulat de départ distinct, puisque les hommes existent encore dans les deux romans : Le rivage des femmes de Pamela Sargent, initialement publié en 1986, et Les nomades du fer d’Eleanor Arnason, initialement publié en 1991, qui ont tous deux été (re)traduits cette année, respectivement chez Mnémos et Argyll. Il demeure des hommes, donc, des hommes caractérisés par leur violence, encore et encore. Alors, dans les deux cas, la décision a été prise par l’ensemble des femmes de les contraindre à vivre de leur côté, seuls ou en tribus, mais LOIN. Et les femmes se sont organisées entre elles.
Les deux romans, s’ils imaginent une situation comparable, appartiennent pourtant à deux genres différents. Le roman de Sargent relève plutôt de la dystopie classique, plus sévèrement marquée que chez Elizabeth Vonarburg. Le monde des femmes, s’il a initialement représenté un havre de progrès scientifique et de paix, n’a rien d’idyllique, avec sa fermeture à toute étude du passé et ses règles intransigeantes, comme en témoigne l’incident qui ouvre le roman : la jeune Birana, jugée coupable de complicité de meurtre alors qu’elle n’a rien fait, est jetée hors de la ville avec sa mère, vouée, les autres femmes n’en doutent pas, à périr dans ce monde hostile où rôdent des mâles sauvages. Outre celle de Birana, on entend se répondre les voix de deux jumeaux qui s’ignorent : Laissa, qui assiste impuissante à l’exil de son amie et à la descente aux enfers de sa propre mère, mesurant peu à peu les limites de sa société, et Arvil, membre d’une des tribus masculines et fervent adorateur, comme ses congénères, de la Déesse. Le roman d’Arnason, lui, s’inscrit plutôt dans la veine de la SF d’exploration et d’observation héritière d’Ursula Le Guin puis reprise par Becky Chambers. L’action se déroule sur une lointaine planète, et la narration, si elle adopte d’abord le point de vue de Nia, l’une de ses habitantes, change ensuite de focalisation et nous met la plupart du temps dans la peau de Lixia, l’une des Terriennes venues sur cette planète avec l’intention d’apprendre, de comprendre, mais d’intervenir le moins possible, à rebours des narrations de colonisation spatiale. Ce qui n’empêche certes pas qu’au sein de l’équipage de Lixia, des conflits se font jour et que, sournoisement, les événements viennent remettre en cause sa promesse initiale de ne pas s’immiscer.
Malgré tout, les jeux d’échos sont multiples entre les deux univers. D’abord, la caractérisation des mâles comme intrinsèquement violents est tout de suite présente : ils sont réputés inaptes à vivre en société, systématiquement agressifs avec les femmes, incapables d’accéder à la technologie. Toutefois, pas de miraculeuse parthénogénèse pour que les femmes se passent entièrement d’eux – et il faut bien que les générations se renouvellent… Arnason écrit en anthropologue, imaginant une société fondée sur une temporalité saisonnière où l’accouplement devient licite, et sur un système d’échange de « cadeaux » qui régule et organise les interactions humaines, y compris sexuelles. Quant aux femmes de Sargent, elles recourent au double pouvoir de la science et de la religion pour attirer les hommes dans les sanctuaires où ils aspirent à être visités par la Déesse, puis les endorment et les abreuvent de rêveries érotiques, le temps de prélever leur semence. Enfin, les deux romans posent la question de l’hétérosexualité comme un objet bizarre, tabou, dont pourtant on ne se débarrasse jamais tout à fait. Si des personnages masculins capables de douceur et d’attachement existent, comme Arvil et, chez Arnason, Enshi, l’amant de Lixia qui demeure à ses côtés au-delà du simple rut, ils demeurent des exceptions, objets de soupçon de la part des femmes comme des autres hommes. Et que faire du désir, de la tendresse, qui parfois s’éveillent chez les femmes, alors même que ces sentiments n’en finissent pas de lutter contre des réflexes de honte, de peur, de dégoût ? Si l’amour hétérosexuel semble pouvoir advenir dans ces deux sociétés, c’est toujours au terme de négociations douloureuses et difficiles des femmes avec leurs partenaires, mais surtout avec elles-mêmes. Il n’est jamais apaisé, jamais évident. Quand Birana semble, après avoir longtemps résisté, développer des sentiments pour Arvil, quand Nia s’attache à Enshi, elles sont marginalisées, rejetées d’une société dont elles ont transgressé une règle élémentaire – mais dans l’espace de cette transgression ne fleuriront pas des romances échevelées, de folles escapades érotiques ou des passions inextinguibles, seulement une sorte de résignation, d’hétéro-fatalisme des espaces ou des temps lointains. Sur Nia se pose le regard de Lixia, qui, loin de s’arrêter à un constat d’étrangeté des mœurs, les comprend trop bien ; sur Birana, Laissa et Arvil, celui de Stéphanie Nicot, qui signe une éclairante préface (à lire de préférence après le roman).
Je ne sais comment conclure cette chronique autrement que sur une note douce-amère, à l’image des romans qui nous laissent avec plus de questions que de certitudes. En 2024, le patriarcat s’est très bien porté merci, et on a lu des beaux textes. Pour 2025, j’ai hâte, au moins, de parler d’autres livres.

Mélanie se balade depuis pas mal d’années dans les mondes littéraires et ludiques de l’imaginaire, avec un peu de recherche universitaire sur les mythes, les âmes et les dragons, un peu d’écriture de nouvelles, et beaucoup de lecture. De temps en temps, elle en sort parce que les programmes de l’Éducation nationale exigent qu’on parle d’autre chose aux lycéen·nes. Elle est convaincue qu’il y a des milliers de trésors à partager en SF et en fantasy, et que le cocktail héros couillu, mentor barbu et récit convenu n’y est pas une fatalité.