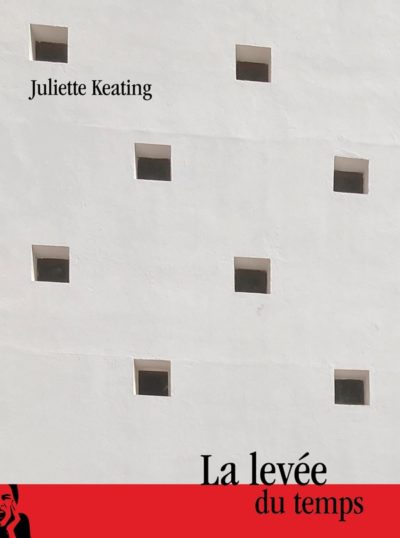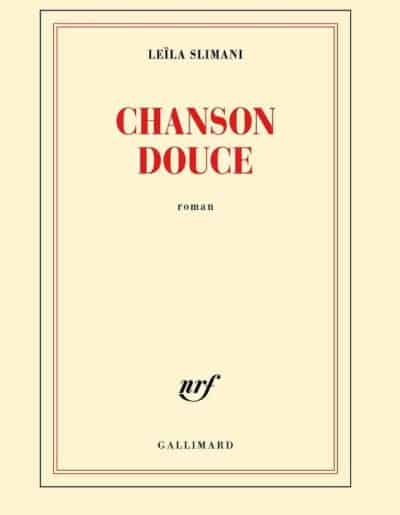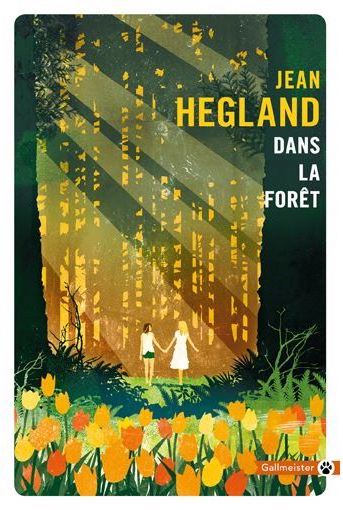La quête de l’indicible
Est-ce que je dévore un roman ou est-ce le roman qui me dévore ? En partant du principe qu’un roman est un ensemble de mots, je peux déduire que les mots peuvent me dévorer. Si les mots voraces de mes lectures grignotent mon humanité, Léna Ghar n’est pas dévorée mais engloutie par un mot qui n’existe pas. C’est l’inconnue magistrale de son roman qu’elle déploie en une suite de courts chapitres qui coupent le souffle d’une langue épuisée par le manque.
En « l’an 3 », la narratrice de Tumeur ou tutu commence sa recherche qui se poursuivra jusqu’à ses 27 ans : elle traverse l’enfance et l’adolescence éduquée par Novatchok et Swayze, et entourée de Grandoux et Petit Prince, tous réunis dans la praison dans laquelle passent quelques spartiates et elle rencontrera ses paladins au gré de ses errances… Qu’est-ce que, quoi ?
Comprenez plutôt : la narratrice habite avec sa mère et son père, entourée de son grand demi-frère et de son petit-frère, tous réunis dans la maison dans laquelle passent quelques adultes, amis de ses parents et elle rencontrera ses propres amis au gré de ses errances de jeune adulte. Jusque là, rien d’anormal. D’ailleurs, « les adultes ne s’inquiètent jamais d’un enfant qui vit avec son papa et sa maman ».

Crédits photo Francesca Mantovani®Gallimard
L’enfance, l’adolescence et BEUM
J’ai tendance à me méfier des romans qui utilisent une langue enfantine pour décrire le monde : difficile de surpasser Emile Ajar dans La vie devant soi, et pourtant, Léna Ghar s’y attèle brillamment. Là où le personnage d’Ajar sillonne les rues de Belleville et façonne son apprentissage du monde depuis l’extérieur, celui de la narratrice de Tumeur ou Tutu se concentre entre les quatre murs de sa praison : savant mélange de maison et de prison. Le ton est donné. Pourtant, depuis l’extérieur, tout porte à croire que cette famille unie nage dans le bonheur : maman est une maîtresse d’école respectée des parents et aimée des enfants, papa incarne la douceur et s’occupe avec fierté de sa petite famille recomposée.
Mais pour la narratrice, maman, c’est avant tout Novatchok, qui n’est pas sans nous rappeler le poison russe qui s’attaque au système nerveux et dont quelques milligrammes suffisent à tuer. Tout est dans le nom : l’évidence nous crève les yeux mais le poison est fourbe, il se glisse dans l’infra-ordinaire, nous dirait Perec, comme la préparation de la fête de l’école :
« Je raconte tout à Novatchok, je suis embarquée par ma propre joie, et la farine, et le papier journal, et l’agrafeuse, et le déguisement des petits spartiates, et le sopalin et le pinceau et la colle et la peinture à l’huile et la petite maîtresse qui nous a montré que BEUM.
La baffe est beaucoup plus grosse que ma tête. »
La suite me laisse coite :
« Ça fait un bruit d’applaudissement raté à cause de ma joue moite. Derrière mes yeux, c’est comme quand la marée remonte, il y a de l’eau, beaucoup, qui dévore le sable. Swayze dit que les vagues sont plus fortes que les humains parce qu’elles ne savent pas se calmer toutes seules, elles ne font que grossir, c’est pour ça qu’elle finissent toujours par nous mouiller les pieds. C’est pas méchant, c’est juste que la mer a besoin de se nettoyer, mais il faut faire attention. »
Difficile de faire attention aux vagues quand on est incapable de les voir arriver mais Novatchok parle, convoque, juge, appelle, hurle, rugit, commente, ironise, déboule, foudroie, force, frappe, tire et s’épuise dans une vie infernale dont ses enfants sont responsables.
Chaque enfant de la maison fait comme il peut : Petit Prince devient imperméable et presque vidé de toute émotion, Grandoux, qui n’est pas sans nous rappeler le Gros-Câlin d’Ajar, se sauve. La narratrice cherche ce qui cloche mais ne trouve pas. La lectrice voit tout mais nage aussi dans l’effroi d’un grand danger jamais nommé.
Les adultes et la polentase
Nous grandissons tous par l’observation et l’imitation et dans ce roman, rien ne vous sera épargné. En lisant, vous vous reconnaîtrez peut-être dans ces spartiates, comprenez ces adultes aux vies bien rangées et à la cécité obligée. Vous verrez tout mais n’aurez rien à dire : le silence se compose de l’évidence. La narratrice décrypte pour nous notre monde adulte et impuissant qui se complait dans une langue faite pour un quotidien ennuyeux dénué de drames. La langue des adultes, c’est une vieille polenta vaseuse et moisie qu’elle nomme si bien « polentase » : elle n’a aucun intérêt et dégoûte clairement, « poubelle direct ».
Entre les amis des parents que rien ne regarde et surtout pas le linge sale et les maîtresses ignorant les pansements pourtant mis en avant, les pirouettes de détresse des enfants ont encore de belles années devant elles.
Peut-être vous reconnaîtrez-vous plutôt en bon paladin, c’est-à-dire en amie remplie de bonnes intentions mais incapable d’aider celle qui se noie dans une violence intra-familiale imperceptible. Vous finirez de toute manière par étouffer de ce mal-être digéré à coups d’alcool et de scènes gênantes, à la manière de Michelle Lapierre-Dallaire dans Y avait-il des limites si oui je les ai franchies mais c’était par amour OK, qui apporte aux dîners « l’ensemble de ses traumatismes d’enfant oubliée » et qui les « étale sur la table […] [en exigeant] qu’on [la] regarde les manger directement sur le plancher avec [ses] mains ». Pourtant, Léna Ghar n’étale rien sur la table car sa narratrice garde tout à l’intérieur. Son tout devient son rien ou plutôt, son rien se transforme en tout, elle ne sait plus trop et puis peu importe : il faut survivre, coûte que coûte.
Mais, soyez rassurés, si vous n’êtes ni spartiate, ni paladin, vous serez peut-être Tendre ou Météore, taillés pour cajoler ou colmater… Ah ben non, dans tous les cas, vous n’y pourrez rien de rien non plus :
« Ceux qui ont été des enfants croient pouvoir compatir à ce genre de récits parce qu’ils n’ont pas la moindre idée de la postérité du bousillage, ni d’à quel point ça les menace aussi. […] Il n’y aura jamais de manière bénigne de transmettre à ceux qui ont été des enfants ce que lègue au corps la trahison des premières braises.[…] comment ça statufie dans la moelle, naître sous un empire où les humains disent je t’aime en même temps qu’ils envoient votre peau au bûcher. »
Les adultes disent, les Hommes frappent, les femmes hurlent, les enfants se taisent. Comment, alors, recouvrer une parole saine ?
L’épuisement de la langue
C’est pourtant le propre de la littérature, nous dit-on, se libérer, évacuer ses traumatismes par l’écrit. D’accord, très bien, super mais la narratrice est confrontée à un enjeu de taille : ce qui la dévore, c’est l’absence de mot. Il n’y a pas de mot pour dire ce qu’elle a vécu et ce qu’elle traverse puisqu’on vous dit que Novatchok l’aime et que tout va bien. Pourtant, quel est ce trou béant qui grossit au fur et à mesure en elle ? Personne, jamais, n’a la réponse :
« […] et puis un jour, tout con, un toubib dans le bled de mes parents […] je vais le voir en désespoir de cause et le mec, carrément, éclate de rire : Ah ! Ça ! Hahaha ! Mais c’est rien du tout monsieur ! Tout le monde en a, simplement chez certains c’est un peu plus proéminent, ça s’appelle une
Que dalle. La délivrance n’arrive jamais. »
Notre langue ne suffit pas à dire l’amour et la violence entremêlés, même les Grecs n’y ont pas pensé entre agapè, storgê et autres philautia, il manque un truc-bidule-pas chouette qui devrait bien pouvoir exister puisque l’enfant le voit, le vit et le sent. Alors l’enfant invente sa langue, néologise pour coller à sa réalité que personne ne veut voir. De toute manière, nommer, ce serait faire exister, on nage quand même bien plus confortablement dans la polentase.
Elle se réfugie alors dans les mathématiques : les symboles de la discipline sont immuables et certains, on peut tout démontrer, il n’y a ni vide ni trou, même l’inconnue s’appelle X et personne n’y trouve rien à redire. Ainsi déroule-t-elle ses équations du bonheur dans des chapitres délicieux de surprises littéraires. On se souvient bien des oulipiens, qui convoquent les mathématiques afin d’instaurer une contrainte d’écriture rigolote et décalée, ou encore de Michèle Audin dans Mai quai Conti, qui conditionne les relations entre ses personnages par la position de points dans une figure géométrique en construisant notamment son intrigue autour d’un théorème mais elle parle elle-même de simple « coquetterie ».
Il n’est point de contrainte rigolote et coquette chez Léna Ghar qui fait du langage mathématique une véritable bouée de décryptage de la psychologie humaine. Ce n’est pas contrainte mais nécessité de survie. Elle applique son raisonnement scientifique et implacable aux affres du traumatisme d’enfance avec une virtuosité littéraire à en réconcilier les deux disciplines ordinairement opposées.
Je pourrais gloser pendant des heures sur Tumeur ou Tutu dont cinquante-sept fois quarante-cinq citations ne suffiront pas à vous faire éprouver la recherche, que dis-je, la naissance d’une langue nouvelle, qui met à mort l’innocence de l’enfance et la folie des adultes en deux-cents et quelques pages mais ce serait désormais vous priver d’une expérience littéraire nécessaire et libératrice. Dans l’équation littéraire, Léna Ghar bouffe l’inconnu tout cru.

J’appelle chacune de mes copines « ma sœur » et la langue française est un chewing-gum : ça se mâchouille, ça se colle partout et surtout, c’est meilleur quand ça s’avale pour s’agglutiner aux tripes. Je suis la reine des images idoines et mon humilité me perdra sûrement en l’an 2053. Je suis une vraie fleur bleue mais comme je suis un signe de feu, disons que je suis un feu bleu. Sinon, je fais des affiches, des rézosocio, des rencontres et des chroniques pour valoriser mes vaillantes sœurs.