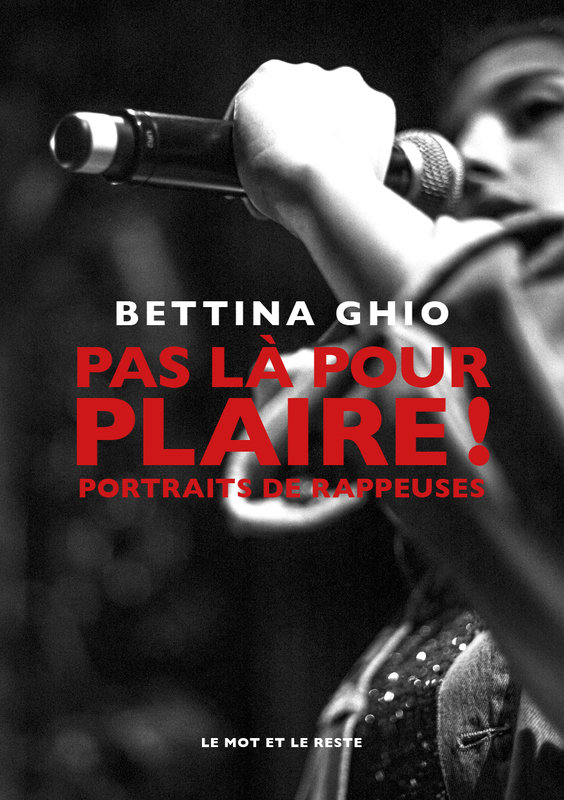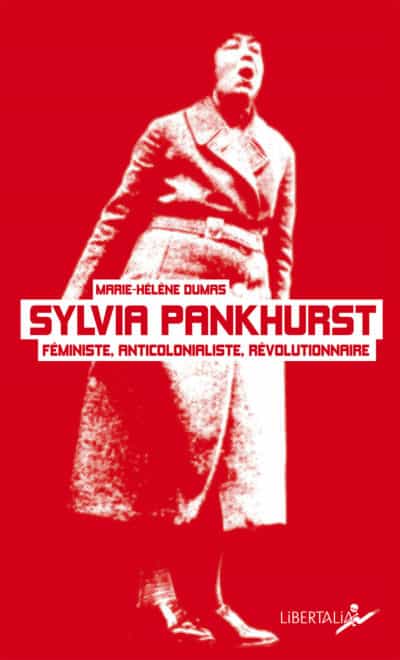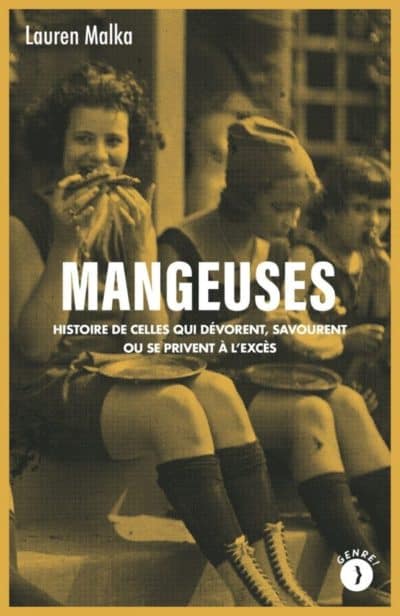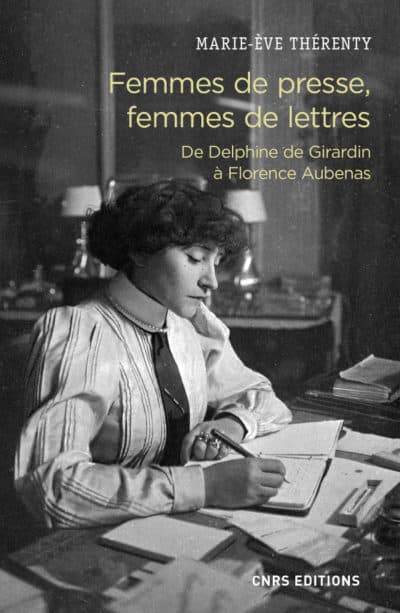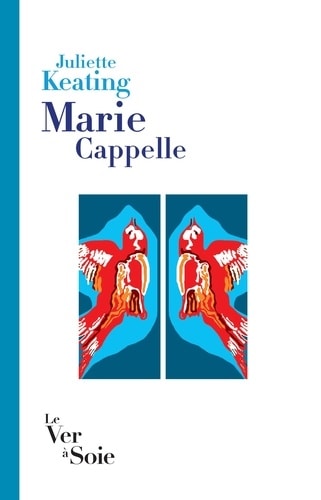Dans cet ouvrage aussi riche qu’instructif, Bettina Ghio met en lumière les parcours des femmes qui ont participé et participent encore activement à l’épopée du rap français. Sexiste, misogyne, dégradant… sont les qualificatifs qui s’appliquent le plus souvent au rap quand il s’agit d’évoquer la place qu’y occupent les femmes, forcément objets, au mieux invisibilisées, au pire reléguées au rang de chiennes soumises à la sexualité débridée et salissante de rappeurs hyper agressifs affirmant une virilité des plus grossière et caricaturale. L’autrice s’applique à déconstruire les stéréotypes qui nourrissent une vision destinée à discréditer une pratique artistique décriée par les élites auto-érigées en gardiennes du bon goût, du bien penser, du bien parler et du bien créer. D’une part, on oublie trop souvent que le rap, comme tous les autres genres musicaux, charrie son lot d’opportunistes qui exploitent le filon commercial au détriment de toute réelle proposition artistique. D’autre part, il semblerait que le droit à la fiction, que l’on accorde sans difficulté à toutes les autres disciplines artistiques, soit dénié au rap.
Violence, misogynie, ego-trip, culte de l’argent seraient donc à prendre au premier degré plutôt qu’à considérer comme un miroir de la société ou une fiction dérangeante aux vertus cathartiques. Quand Nick Cave enregistre l’album Murder Ballads dans lequel il relate, à la première personne, une série de meurtres de sang-froid (dix chansons, soixante-cinq victimes), personne ne s’offusque ni ne condamne le rockeur pour appel au meurtre. Droit à la fiction. Or les rappeurs sont majoritairement issus des quartiers populaires et enfants d’immigrés venus d’anciennes colonies. De là à dire que le sexisme, la violence et le mauvais goût qui sont imputés au rap de façon systématique et sans questionnement relèvent d’un mépris de classe, il n’y a qu’un pas (que je franchis allègrement).
Les accusations de misogynie portées contre le rap semblent donc à remettre en perspective, mais Bettina Ghio ne s’arrête pas là : elle montre que si c’est un rap plutôt masculin qui est mis en avant, avec une tendance à glorifier les grosses voitures et les femmes-trophées déambulant en string au bord de piscines à débordement, c’est aussi parce que les maisons de disque françaises, dirigées majoritairement par des hommes, non issus des quartiers populaires, préfèrent mettre en valeur cette image rebattue plutôt que de se risquer à produire un rap conscient, plus subtilement contestataire, et (un peu) plus souvent féminin.
Il y a donc des femmes dans le rap, et si Diam’s est la plus célèbre, elle n’en est ni la seule ni la première représentante. Bettina Ghio entreprend un parcours chronologique qui commence par les pionnières. En 1990, une seule femme figure sur la première compilation Rapattitude! qui signe en quelque sorte la naissance officielle du rap français : il s’agit de Saliha, avec le titre Enfants du ghetto. Le deuxième album de l’artiste intitulé Résolument féminin abordera explicitement des thématiques liées à la condition féminine comme les violences conjugales avec Derrière la porte. Ce sont ensuite B-Love, Sté Strausz, Lady Laistee, Princess Aniès, Bams, dont le titre Douleur de femme qui contient un sample de la BO du film Bagdad Café constitue « pratiquement un hymne féministe » selon l’autrice.
Toutes ont en commun de traiter dans leurs chansons des thématiques comme la maternité, la monoparentalité, la spécificité d’être une femme qui évolue dans le milieu du rap, les diktats de la beauté, mais aussi de proposer, comme un certain nombre de leurs homologues masculins, une réflexion post-coloniale qui ébranle les fondations du roman national français et exhibe les impensés de l’histoire coloniale européenne.
Puis viennent les années 2000 et le couronnement de la plus populaire des rappeuses : Diam’s, « réelle des ovaires jusqu’aux canines », (Madame qui?), en featuring avec Lady Laistee dans Un peu de respect sur un sample du mythique Respect d’Aretha Franklin, comme un hymne à la sororité artistique. Diam’s élabore, selon Bettina Ghio, une street credibility au féminin qui, contrairement à celles des rappeurs, n’est pas le fruit d’affrontements fréquents avec la police ou de séjours en prison mais est acquise par l’expérience urbaine spécifiquement féminine : peur de la mauvaise rencontre en rentrant seule le soir, violence conjugale ou même, fracas du cœur brisé par les illusions de prince charmant. On retrouve en particulier ces thématiques dans Incassables : « j’évite les rues la nuit car le viol est à la mode » ou dans Big up, qui célèbre la force des femmes : « t’as la patate ma sœur parce que t’es belle et qu’t’es pas conne tu te respectes et tu le sais t’es la patronne, t’es archi bien, t’es une boulette, t’es une fusée ».
Deux autres figures du rap s’inscrivent dans la durée. D’une part, Keny Arkana, insurgée permanente particulièrement engagée dans les mouvements altermondialistes et qui témoigne dans ses textes de sa difficile expérience de vie à la rue, aussi bien que plus tard de son séjour fécond chez les Zapatistes. Des titres comme La Rage ou Nettoyage au Karcher rendent compte de sujets d’actualité brûlants et appellent à une insurrection qui ne semble pas avoir de sexe. D’autre part, Casey, qui récuse radicalement les assignations de genre en adoptant des tenues très masculines, assumant un « je-banlieusard » ni féminin ni masculin. Bettina Ghio précise que Casey n’est pas signée par les grandes maisons de disque et reste indépendante car elle n’est Pas à vendre, définitivement inclassable ainsi qu’elle se plaît elle-même à le rappeler dans ses textes où elle apparaît comme une « créature ratée », un « bordel hybride », rejetant les stéréotypes liés à la féminité dans Mes Doutes en 2014 avec Asocial Club : « Me parle pas de féminité, j’ai du poil plein les aisselles / Je vais te laisser tes hypothèses sur la dentelle, la vaisselle ». Ainsi s’exprime « l’exclue à la gueule masculine » dans l’autobiographique Rêves illimités :
… Pour l’avoir vue sur scène dans Viril, mis en scène par David Bobée en 2020 aux côtés de Béatrice Dalle et Virginie Despentes – pas spécialement connues pour passer inaperçu – je peux témoigner que l’irruption sur scène de Casey, son phrasé, son énergie, sa justesse lorsqu’elle nous a livré une lecture-interprétation du texte d’Audre Lorde « De l’usage de la colère : la réponse des femmes au racisme », a laissé toute une salle le souffle coupé et l’estomac noué.
Bettina Ghio achève ce parcours en présentant les héritières comme Shay, Liza Monet, Chilla et ses titres qui occupent ouvertement la scène féministe (Sale chienne, #Balance ton porc, Si j’étais un homme), KT Gorique, La Gale, les soeurs Orties (carrément flippantes dans Plus putes que toutes les putes), Pumpkin, Black Barbie avec son Rap de Bonne Femme qui commence sur ces mots : « ça c’est un rap de bonne femme cru, franc, dur et brutal, comme les coups qu’elle se prend quand il y a violence conjugale, comme les contractions qui te crispent sur ton lit d’hôpital (…) rien que des punchlines méchantes comme les remarques du policier qui enregistre ta main-courante… » :
Cependant, peu d’entre elles accède à un nombre de vues vraiment significatif, ce qui confine les rappeuses d’aujourd’hui dans un statut relativement confidentiel… d’où l’intérêt du travail de Bettina Ghio qui les met en lumière et analyse leurs parcours, parfois encore débutants. Plusieurs de ces artistes endossent une posture de violence décomplexée, de femme-bandit dominante et indépendante, parfois armée, sexuellement active et décomplexée. On peut se demander s’il s’agit d’une sorte de machisme inversé aux vertus libératrices mais peu fécond dans la durée tant il ne propose pas de nouveau modèle. Cependant, Bettina Ghio propose d’envisager cette posture de bad bitches comme une mise en scène de soi constituant une des facettes de l’émancipation des femmes, et en particulier pour les femmes noires dont les corps sont habituellement invisibilisés et davantage encore chosifiés et méprisés que ceux des femmes blanches dans l’espace public.
Non seulement le livre remarquable de Bettina Ghio se lit casque sur les oreilles, et permet d’élaborer au fil de la lecture une playlist Pas là pour plaire des plus réjouissantes, mais il nous propose aussi des grilles d’analyse qui s’appuient sur les lectures de Frantz Fanon, Aimé Césaire, Virgine Despentes, Angela Davis, ou encore des récents travaux d’Elsa Dorlin sur la violence et qui permettent d’élargir le champ de l’analyse artistique et littéraire à celui du politique. Le commentaire, l’usage de références extra-musicales, la glose qui élèvent le rap à une dignité universitaire à laquelle il n’aspire peut-être pas, n’érodent en rien sa puissance subversive mais entérinent définitivement sa présence, et ici plus particulièrement celle du rap féminin, dans l’espace artistique dont il quitte peu à peu les marges pour s’installer au centre, en toute légitimité.

Après s’être aperçue qu’en 116 ans d’existence le Goncourt avait été attribué à 12 femmes et 104 hommes, elle s’est dit que certes, une chambre à soi et un peu d’argent de côté ça pouvait aider à écrire des livres – et que les femmes manquaient souvent des deux – mais qu’il y avait quand même, peut-être, un petit problème de représentation dans les médias. C’est ainsi qu’elle a décidé de participer à Missives, heureuse de partager son enthousiasme pour les autrices qui la font vibrer, aimer, réfléchir et lutter.