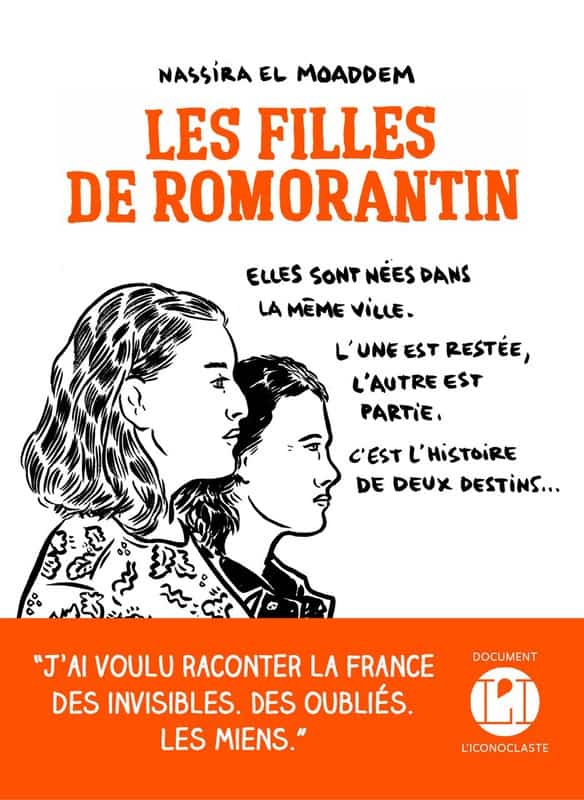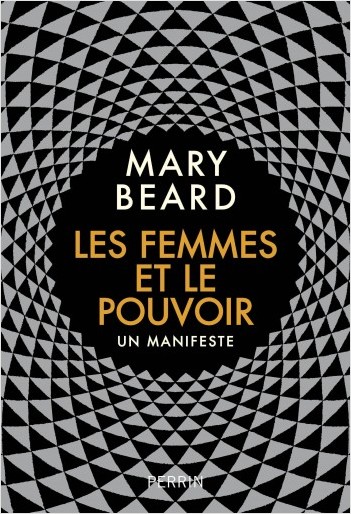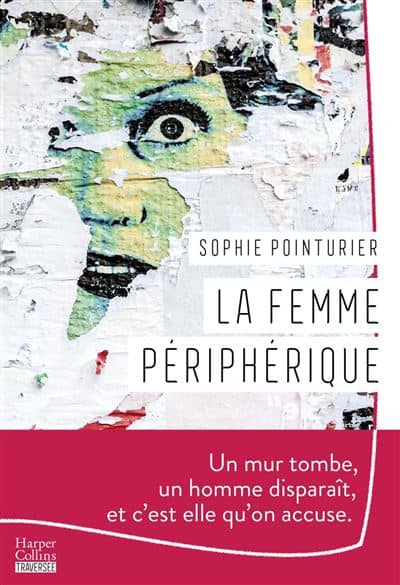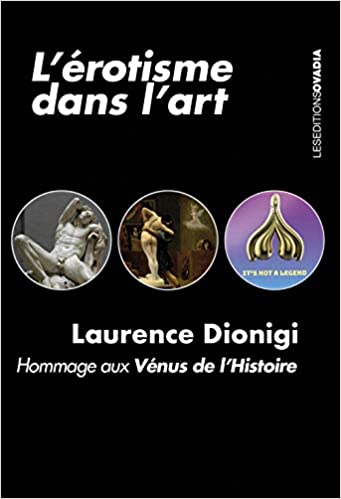La journaliste Nassira El Moaddem signe un document éclairant sur sa ville natale et celleux qui y sont resté·e·s alors qu’elle en est partie.

L’année dernière, ma grand-mère a eu 80 ans. Pour fêter dignement cet événement, nous nous sommes retrouvé·e·s dans un gîte le temps d’un week-end, au vert, au calme, loin de nos quotidiens et situé à peu près à égale distance des lieux d’habitation de chacun. Le délicat compromis avait été trouvé en Sologne. Facile d’accès lorsqu’on est motorisé·e (toute ma famille sauf moi) – moins simple en train… Je m’apprêtais donc à profiter de ces longues heures de voyage pour m’adonner à une de mes activités favorites : admirer les paysages de notre magnifique pays en rêvassant. Mais pour se rendre à Vernou-en-Sologne depuis Lyon, il fallait changer à Gièvres pour ensuite arriver à la ville la plus proche : Romorantin.
Arrivée à Gièvres, je n’ai pu que m’émerveiller de sa minuscule gare. Elle semblait posée là, hors du temps, vieux bâtiment voyant circuler des machines plus ou moins modernes. J’étais seule. Les lieux semblaient faits uniquement pour les habitué·e·s : il me semblait être au bon endroit pour ma correspondance, mais sans en être tout à fait sûre. Je me rassurais en me disant que ce serait bien le diable qu’il arrive deux trains dans cette petite gare, à la même heure, pour deux directions différentes, justement au moment où je devais en repartir.
Un petit TER flambant neuf, détonnant dans le paysage, est arrivé à l’heure indiquée sur mon billet : je suis montée à bord d’un air faussement blasé. Et quand il a démarré, j’ai eu l’impression de faire un saut dans l’espace-temps : la ligne circulait dans des bois, desservait des gares qui étaient architecturalement des arrêts de bus, et s’est même arrêtée en pleine forêt devant une sorte de cabane posée au milieu d’une clairière… Je n’aurais pas été aussi émerveillée si j’étais montée à bord du Poudlard Express : je trouvais génial qu’une telle ligne existe en France, et surtout, qu’elle soit toujours en service.
Une fois arrivée à Romorantin, j’ai raconté mon périple à mes parents venus me chercher, leur décrivant les petites gares, les arrêts improbables, et la chance qu’on avait de vivre dans un pays où de telles lignes étaient encore possibles – mais pour combien de temps ?… Un an plus tard, quasiment jour pour jour, j’ouvre le livre de Nassira El Moaddem qui écrit : « Le petit train du Blanc-Argent, c’est pittoresque et magique pour les touristes qui viennent passer un week-end, mais quelle tannée pour celles et ceux qui doivent régulièrement rentrer au pays, quelle plaie pour tous ces jeunes qui rêvent d’évasion ! » et c’est un premier pincement au cœur, de ceux que l’autrice narre tout au long du livre, de sa position d’échappée (à la fois de sa condition sociale et son lieu de naissance) qui est aussi la mienne (d’une autre ville, cela dit) et à laquelle je me suis toujours bien gardé de m’attarder trop longuement.
Parce que ce livre, c’est autant le portrait d’un territoire blessé par la fermeture d’une usine (Matra, celle qui fabriquait les Renault Espace – en l’occurrence je n’en avais jamais entendu parler) que celui de quelques-uns de ses habitants (surtout des femmes), que de celle de l’échappée qui y revient : Nassira El Moaddem réussit l’exercice délicat de parler à la première personne tout en livrant un récit avec une rigueur journalistique qui ne fait jamais défaut. Elle navigue avec aisance entre son point de vue d’enfant du pays et celui de journaliste infiltrée pour mieux nous faire saisir les problématiques sociales actuelles : le mouvement des Gilets Jaunes, à travers l’histoire de Caroline, sa meilleure amie de l’école primaire ; les portes des banques qui restent fermées lorsque Otmane, un quasi-frère, décide de monter son garage avec un nom dont la consonance ne plaît pas ; les arrangements du maire, en poste depuis la naissance de l’autrice, avec les puissants locaux ou nationaux ; et surtout les difficultés d’avoir un salaire qui couvre l’ensemble des factures lorsqu’on est une femme seule et qu’on élève des enfants. Pour son enquête, Nassira El Moaddem ira même jusqu’à se faire réembaucher sur le lieu d’un de ses anciens jobs d’été (en l’occurrence, personnel de ménage à Center Parcs) pour voir sur pièce comment les conditions de travail ont évolué.
« Les filles de Romorantin », à travers de nombreux portraits de ses habitants des milieux les plus défavorisés, est une loupe grossissante sur la crise sociale que traverse notre pays, et permet de l’appréhender en déconstruisant des clichés grotesques (voire carrément racistes) et des raccourcis véhiculés par certains médias. C’est aussi une réflexion sur le métier de journaliste et sur le rôle des chaînes d’info en continu sur l’exaspération et la méfiance des ouvriers, sur les scores des partis d’extrême-droite dans ces petites bourgades et sur les privilèges de la classe moyenne.
Tout ceci dans un livre à l’écriture fluide, touchante, bien assise sur des enquêtes de terrain entremêlées aux réflexions personnelles de l’autrice. Ce mélange tour à tour nostalgique, âpre, plein de tendresse et de fiertés fait de ce récit un portrait salutaire de ce monde qui échappe aux puissants.
Florence Porcel – Ton livre s’appelle Les filles de Romorantin, il présente deux femmes en couvertures (Caroline et toi-même), il met l’accent sur deux destins féminins… Pourquoi ce choix, puisqu’on y trouve aussi des portraits d’hommes, et des portraits d’autres femmes ?
Nassira El Moaddem – Je me suis rendu compte très vite en revenant dans la durée à Romorantin pour ce projet que les proches et habitants que je retrouvais étaient souvent des femmes. Il y a Caroline, ma meilleure amie d’enfance à l’école primaire avec qui je renoue après que nous nous sommes perdues de vue, Lucia, une des voisines de ma maman, Karine la contrôleuse du petit train de campagne, Najat, une de mes amies de Romorantin… J’avais envie de les mettre en avant parce qu’elles sont un peu, pour moi, des résistantes du quotidien : des mères célibataires qui se plient en quatre pour élever leurs gosses, une cheminote qui s’est battue pour ne pas voir ce petit train disparaitre, une dame de nettoyage qui attend sa retraite avec impatience…. Et puis, il y a les parcours des hommes, ceux de mon entourage qui méritent tout autant que d’autres d’être racontés : mon cousin Hamid, l’ami de la famille Otmane…
FP – Tu as des parents immigrés, mais tu as grandi dans un pavillon. Tu as dirigé un média, mais centré sur les diversités ethniques et la banlieue. Tu fais partie de la classe moyenne, mais tu subis racisme et sexisme. Est-ce que c’est cette position permanente « d’entre-deux », ces allers-retours entre certains privilèges et le renvoi incessant à tes origines et à ton genre, qui t’a donné envie d’écrire ce livre ? Ou, formulé autrement, as-tu livré ce récit depuis le prisme de l’intersectionnalité ?
NEM – J’ai grandi dans des petits bâtiments de logements sociaux d’un village du Loir-et-Cher, Selles-sur-Cher jusqu’à mes 7 ans avant d’aller à la ville la plus proche, Romorantin, où mes parents ont pu enfin construire leur pavillon. J’ai ensuite fait de longues études comme le voulait mon père pour chacun de la fratrie, trois filles, trois garçons. J’aime bien cette idée d’allers retours parce que c’est de cela dont il s’agit. Nous ne sommes pas figé·e·s dans nos identités. Elles s’entrecroisent, elles ne cessent de se rencontrer, parfois en s’entrechoquant mais souvent aussi en vivant ensemble sans trop de bousculades. Mais ces identités multiples interrogent, c’est certain : suis-je toujours fille d’ouvrier en étant devenue journaliste, suis-je toujours Solognote et Romorantinaise en étant désormais Parisienne ? J’avais besoin de réponses à ces questions qui me traversent.
FP – Les femmes, et a fortiori seules avec ou sans enfant, sont celles qui souffrent le plus de la précarité. Tu dresses le portrait de plusieurs d’entre elles. Quel regard ont-elles sur leur condition ?
NEM – Très froid, c’est-à-dire qu’elles ont conscience de leurs difficultés mais ne s’apitoient jamais. Elles avancent, font, construisent, avec le peu de moyens : ici une qui s’investit dans l’association de parents d’élèves du quartier, l’autre qui s’engage dans les Gilets Jaunes, une autre qui « rêve » de venir en aide aux autres une fois la retraite prise. Ce sont des femmes investies dans les solidarités autour d’elles.
FP – Tu es journaliste. Pourquoi avoir décidé de publier un livre, plutôt qu’une enquête dans un journal ?
NEM – Parce que nous avons souvent besoin de temps et d’espace et que ces deux-là sont de moins en moins possible dans des enquêtes de journaux. Et puis, c’est un travail assez particulier que j’ai mené ici : c’est à la fois une enquête journalistique faite d’observations de terrain, de recherches, de recueils de témoignages, d’interviews et une introspection personnelle dans mon Romorantin, celui de mon enfance avec celui que je regarde aujourd’hui avec mes yeux d’enfant du pays. Seul le livre me permettait de réaliser ce travail de cette manière.
FP – Est-ce que la journaliste que tu es traitera différemment certains sujets, maintenant que tu as mené cette enquête ou publié ce livre ? Formulé autrement, en quoi cette expérience t’a fait évoluer professionnellement (ou pas) ?
NEM – Je n’ai pas l’impression que ce travail m’a amenée à avoir un regard différent sur ces sujets. En revanche, mon parti pris de revenir dans ma ville pour raconter avec ce double regard de Romorantinaise et de journaliste m’a amenée par définition à raconter le devenir de cette petite ville de manière singulière. Et puis, ce projet m’a donné encore plus envie de documenter ma région d’origine. Jamais je n’avais imaginé que je puisse faire ce travail de journaliste à Romorantin. Pour moi, journaliste, cela voulait dire aller étudier ailleurs, et exercer ailleurs aussi. J’avais imaginé tous les terrains, sauf celui-ci ! Aujourd’hui, j’imagine un tas de reportages, d’enquêtes sur Romorantin, la Sologne, le Loir-et-Cher, je ne cesse de gribouiller à droite à gauche sur des sujets que je connaissais mais que je n’avais pas imaginés dans une dimension journalistique. Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour faire son métier de reporter.
En librairie depuis le 16 octobre 2019. Publié chez L’Iconoclaste. 205 pages, 17 euros.

Florence Porcel est autrice, actrice et animatrice. Elle travaille surtout dans le milieu de la vulgarisation scientifique et intègre toujours une réflexion féministe à ses activités. Après avoir été animatrice sur France 5 et France Inter, elle a publié trois livres et une bande dessinée.