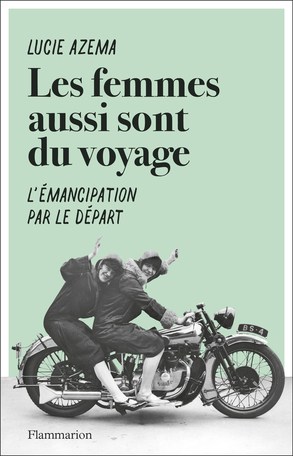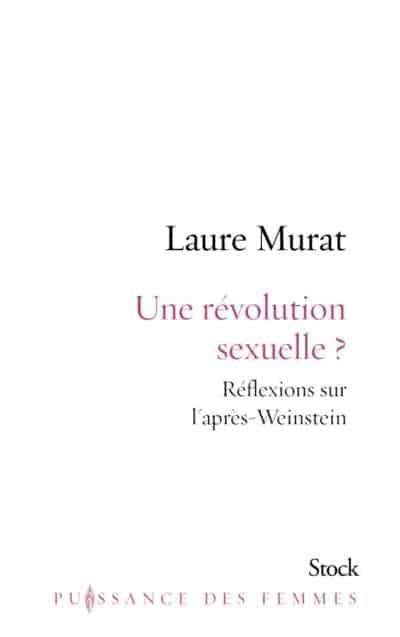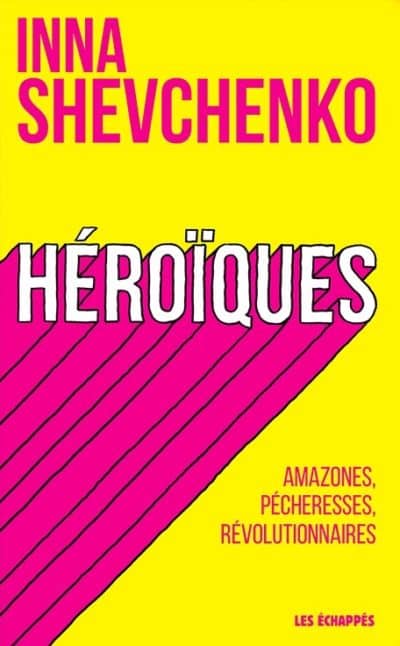Une fois n’est pas coutume, l’objet de cette chronique est une revue, toute nouvelle venue dans le monde de la presse écrite dont on ne cesse d’annoncer la mort imminente : et pourtant, quelle vitalité ! Un verbe à l’infinitif comme ligne directrice de chaque numéro, et logiquement « Naître » pour le premier, pulvérise d’emblée la place d’objet que certain.e.s aimeraient encore trop souvent assigner aux femmes. Fébrilité, émotion, reconnaissance : vous trouverez La Déferlante en librairie ou dans votre boîte aux lettres si vous choisissez de vous abonner, ce qui, rappelons-le, recouvre une importance capitale pour permettre à la revue de conserver son indépendance. Cette chronique se fera exceptionnellement à deux voix et quatre mains, tant la forme dialoguée apparaît comme l’essence même de La Déferlante.
Marie : La Déferlante, c’est une vague de fraîcheur. On tient ces 160 pages dans les mains qui réunissent des sujets qu’on doit souvent glaner par soi-même sur des fils d’actualité, dans des podcasts, éclatés un peu partout sur la toile et on se dit que les quatre co-fondatrices nous simplifient la vie, nous font gagner un temps fou et nous permettent de donner une dimension archivable à l’actualité des luttes. Marion Pillas, Lucie Geffroy, Marie Barbier et Emmanuelle Josse ont imaginé un bel objet papier, merveilleusement illustré par des graphistes pour le plaisir des yeux. Un bémol : le choix graphique du dos de la revue, j’aurais apprécié un design plus tape-à-l’œil dans la lignée de La Revue Dessinée pour trouver toute sa place dans ma bibliothèque parmi les livres de Toni Morrison, les poèmes de Renée Vivien, la BD Bitch Planet, ou les essais de Chimananda Ngozi Adichie.
Lucie : C’est vrai que le travail d’illustration est remarquable. L’alternance entre les textes, la bande dessinée et le portfolio qui nous permet de découvrir le travail de l’excellente Nancy-Wangue Moussissa à travers ses photographies, donne à la revue un aspect protéiforme et engendre un dialogue entre différentes formes artistiques. Le dialogue est même la porte d’entrée de ce premier numéro qui débute par un entretien croisé entre Annie Ernaux et Céline Sciamma, deux figures de combattantes certes, mais qui ont aussi en commun le regard tendre qu’elles portent sur les femmes. L’échange est riche, ancienne et nouvelle génération sont complices, curieuses l’une de l’autre, travaillent dans leurs œuvres à une continuité des luttes. La conversation se poursuit dans des formes variées, comme dans la carte blanche où Alice Zeniter nous livre un très beau texte sur l’extraordinaire Zora Neale Hurston sous la forme d’un bel hommage d’autrice à autrice, qui traverse les continents et les générations. Dialogue aussi dans l’article intitulé « Que faire des violeurs ? », où débattent la sociologue Véronique Le Goaziou, l’autrice Valérie Rey-Robert et le directeur de centre socio-judiciaire François Roques. La confrontation des points de vue n’est pas un pluralisme de façade mais l’occasion de réfléchir ensemble avec honnêteté. Ainsi La Déferlante semble être le lieu d’une polyphonie réjouissante où les voix de théoriciennes, d’universitaires, de militantes, d’artistes, d’anonymes se croisent et s’unissent à travers les générations, les aires géographiques et les formes artistiques.

Marie : Oui, cet espace de dialogue dont tu parles est crucial. On évite de tomber dans la pensée unique, dans un regard qui accapare tout et rejette les sensibilités dissonantes dans l’ombre. De la même manière que les pages de Despentes sur la prostitution m’avaient remuée, comme un bâton touille le fond de la mare et en brouille la clarté, certains témoignages de la revue sont là pour gêner notre bulle de confort, ces petites certitudes bien en place, et qui nous voilent un côté du problème : le témoignage de Barbara, ancienne détenue, ou d’Adèle Orain dans son texte « Nous naissons de partout » sur sa transition, m’ont particulièrement bousculée. Je trouve que les verbatim, ces paroles brutes sans commentaires sont un contrepoint essentiel à la parole plus construite, savante des articles de journalistes. Du coup, la revue élabore page à page une culture théorique qui a vocation à faire œuvre de référence mais n’omet pas les voix qui ne confirmeront pas toujours la règle. C’est d’ailleurs un peu la même intention qu’on poursuit sur Les Missives : collecter des œuvres, des avis sur ces œuvres, réunir à la façon des encyclopédistes du XVIIIe siècle les connaissances que nous avons pour faire monde.
Lucie : Un travail d’encyclopédiste, oui, mais qui n’est pas seulement un état des lieux des connaissances ou une compilation. Comme indiqué dans le manifeste liminaire, La Déferlante ne se place pas « au-dessus de la mêlée : elle prend parti. » Je trouve que le choix d’Élise Thiébaut de faire le portrait de Françoise d’Eaubonne dans ce premier numéro (et pas de Simone de Beauvoir par exemple) place la revue dans une ligne qui préfère le pas de côté et les chemins de traverse à la route tracée par des féminismes plus traditionnels, sans pour autant renier leur apport. De même, finir la revue par les mots d’Audre Lorde, c’est s’inscrire dans une perspective intersectionnelle revendiquée, c’est aussi opérer un bouleversement qui ne pense plus un centre et ses marges mais des racines qui communiquent entre elles, à l’horizontale, sans hiérarchisation.
Marie : J’adore le planisphère qui ouvre la revue. On mesure l’ambition des fondatrices de proposer une autre projection du monde dessinée par Léonie Schlosser, alternative à celle de Mercator, eurocentrée et pourtant largement dominante dans les représentations. Le monde s’y trouve chamboulé, cul par-dessus tête, comme notre désir de déranger le bel ordre des choses, organisé sans nous, pour nous. À chaque parution, les combats féministes planétaires qui y sont pointés tissent une internationale des luttes, comme on la rêvait au siècle dernier parmi les ouvriers. Parce que faire du lien, lancer des fils entre des communautés, des causes, voir ce qui réunit, c’est le noyau de l’action politique. Ces océans qui séparent les terres les mettent aussi en contact quand les eaux montent.
Lucie : En effet, la métaphore liquide est féconde et je trouve le titre particulièrement bien choisi. Les mouvements féministes ont souvent été scindés dans le temps par le choix du terme « vague » : première vague concernant l’obtention du droit de vote et des droits fondamentaux, deuxième vague dans les années soixante plus attentive à la sexualité et aux violences conjugales, troisième vague pour la nouvelle génération qui se veut plus inclusive dans les années quatre-vingt en amorçant la réflexion sur l’intersectionnalité, enfin quatrième vague qui est la nôtre depuis 2012 où les réseaux sociaux ont donné aux luttes une dimension nouvelle. Le titre de la revue nous invite à ne pas attendre de cinquième, sixième ou septième vague mais à participer dès maintenant à ce mouvement puissant qu’on ne semble plus pouvoir arrêter. Ceux et celles qui espèrent voir la mer se retirer à la prochaine marée peuvent toujours attendre, La Déferlante est arrivée !
Marie : Carrément. Je repense à l’image de la marée de Maya Angelou dans Still I rise :
Surgissant d’un passé enraciné de douleur
Je m’élève
Je suis un océan noir, bondissant et large,
Jaillissant et gonflant je porte la marée.
Ou encore au déluge final du livre de Zora Neale Hurston, Et leurs yeux dardaient sur Dieu : il faut nager dans les torrents de boue qui menacent de nous emporter, s’accrocher aux planches de fortune qui flottent ici et là. La déferlante, on la redoute pour son pouvoir de destruction, mais on l’attend aussi, car elle tire la chasse-d’eau sur le vieux monde.
Lucie : Et ce serait quoi le mot de la fin après avoir tiré la chasse d’eau ?
Marie : Que La Déferlante nous aide, comme le dit Audre Lorde, à descendre au plus profond de nous-mêmes « pour atteindre la terreur et le dégoût de toute différence qui s’y terre (…) Alors seulement, le personnel comme le politique pourront commencer à éclairer tous nos choix. »
Un article de Lucie Giovanetti et Marie Rondou
Marie et Lucie écrivent parfois à quatre mains.
Marie rêvait de tenir un ranch dans le Wyoming, mais sa phobie de l’avion l’a poussée à embrasser la carrière d’enseignante à Montreuil pour partager sa passion des grands espaces littéraires.
Après s’être aperçue qu’en 116 ans d’existence le Goncourt avait été attribué à 12 femmes et 104 hommes, Lucie s’est dit que certes, une chambre à soi et un peu d’argent de côté ça pouvait aider à écrire des livres – et que les femmes manquaient souvent des deux – mais qu’il y avait quand même, peut-être, un petit problème de représentation dans les médias. C’est ainsi qu’elle a décidé de participer à Missives, heureuse de partager son enthousiasme pour les autrices qui la font vibrer, aimer, réfléchir et lutter.